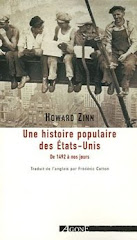S’il est un film à ne rater sous aucun - oui vous avez bien lu ! - aucun prétexte, c’est bien celui-ci.
S’il est un film à ne rater sous aucun - oui vous avez bien lu ! - aucun prétexte, c’est bien celui-ci.
A la base, projet impossible à monter pour le cinéma, La journée de la jupe a bénéficié du soutien financier d’Arte qui, en le diffusant quelques jours avant sa sortie officielle en salle, a réussi l’exploit de réaliser 9,6% de part de marché le 20 mars dernier (soit l’une des meilleures audiences de la chaîne depuis le début de son existence).
Pour ce résultat, Jean-paul Lilienfeld, le réalisateur, n’a pas hésité à mettre le meilleur des atouts de son côté. En proposant ce rôle de prof au bout du rouleau, qui se retrouve presque malgré elle à braquer ses propres élèves, à l’une des actrices les plus rares, les plus sensibles et les plus impliquées que le cinéma français ait jamais eu, il a misé fort et juste.
Digne, bouleversée et réellement bouleversante, Isabelle Adjani y est une nouvelle fois incomparable. Difficile d’imaginer une autre femme dans ce registre engagé mais subtil qui, on le sait déjà, lui va comme un gant. Il faut la voir, le flingue (énorme) à la main, dans le silence impressionnant de cette salle capitonnée, réciter un cours sur Molière « ... Jean-Baptiste Poquelin !!!!! », et engager un dialogue primordial, capital, sur la laïcité. Car c’est bien là le principal sujet de cette fable sociale. Celui qui la rend si pertinente et essentielle. En appuyant son discours sur les préceptes et les fondements même de l’école publique, Lilienfeld (pas exempt de lourdeurs, de clichés mais qui s’en accommode au mieux) développe un magnifique plaidoyer sur l’égalité, la mixité, le respect sous toutes ses formes, au travers duquel le langage, le verbe, se révèle être l’arme la plus efficace.
A savoir : la revendication du titre, réclamée au Ministre de l'Éducation Nationale par Sonia Bergerac (Isabelle Adjani), est tout à fait d’actualité puisque l'association Libertés Couleurs (comme d'autres) est déjà, depuis plusieurs années, l’initiatrice d'un Printemps de la jupe et du respect (voir le site).
mardi 31 mars 2009
LA JOURNEE DE LA JUPE
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
4
commentaires
![]()
vendredi 27 mars 2009
WARHOLA REPLAY
 Est-ce rendre hommage à l’une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années que de lui consacrer une exposition/portrait des « grands de ce monde » ? Pas certain !
Est-ce rendre hommage à l’une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années que de lui consacrer une exposition/portrait des « grands de ce monde » ? Pas certain !
Surtout quand au bout de quelques salles la nausée s’installe et la lassitude (250 toiles quand même !) l’emporte sur l’émerveillement que provoquent, dès l’entrée, ces fameuses séries de Marylin, icône transcendée et transgressée qui perd avec Warhol toute son humanité pour n’être plus qu’une image comparable à celle de milliers d’autres, aussi colorée et désincarnée qu’une boîte de soupe Campbell's. Dans ce Grand monde d'Andy Warhol (quel titre ridicule !), indigeste et répétitif, tout tombe à plat. En oubliant volontairement une grande partie du travail de « l’artiste » (ce que Warhol ne se considérait pas), Alain Cueff, le commissaire, est totalement inapte à développer un discours capable de susciter le moindre intérêt.
On déambule de plus en plus rapidement au fil d’un accrochage très discutable (même si certaines œuvres un peu inattendues comme cette Big Electric Chair, 1967, valent la visite) en constatant, avec dommage, ce qu’aurait pu donner une véritable rétrospective, ambitieuse, décadente, où les réflexions de « la Warhola au gros nez rouge », ici de simple extraits d’interviews misérablement collés sur les cimaises d’une scénographie tellement minimaliste qu’elle en perd tout intérêt, auraient pris tout leur sens, celui d’une certaine philosophie de la vie vu à travers le prisme de la Factory.
Les informations succinctes – 25 000 dollars pour le premier panneau, 15 000 pour les suivants …, ou la date à laquelle il commence à utiliser la poudre de diamant - ne relèvent jamais la laideur de cartels ÉNORMES et inutiles. Rien à dire. Tout est là, devant nos yeux, l’intelligence d’un Warhol, obsédé par le fric, étant d’avoir créé un process lui permettant « d’industrialiser » l’art et notamment l’art du portrait pour en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant : une critique acerbe et pertinente de la société. Visiblement, au Grand Palais, on l’a complètement oublié ou volontairement occulté. Une vraie grande déception !!!



Publié par
rupert
Libellés :
Expos
5
commentaires
![]()
jeudi 26 mars 2009
LaCHAPELLE : RECOLLECTIONS
 Première exposition emblématique issue du fameux « Conseil culturel » de la monnaie de Paris, mis en place au printemps 2008 par son Président-Directeur général Christophe Beaux, la « rétrospective » David LaChapelle est un événement pour plusieurs raisons.
Première exposition emblématique issue du fameux « Conseil culturel » de la monnaie de Paris, mis en place au printemps 2008 par son Président-Directeur général Christophe Beaux, la « rétrospective » David LaChapelle est un événement pour plusieurs raisons.
D’abord le choix, extrêmement « people », de présenter dans l’une des plus anciennes institutions françaises le travail d’un photographe branché moins reconnu dans le milieu artistique que dans celui, d’ailleurs pas forcément plus ouvert, de la fashion culture américaine. Ensuite parce que LaChapelle n’a encore jamais bénéficié d’une telle exposition dans nos contrées hexagonales et que, même si cette présentation ne constitue que l’une des nombreuses haltes d’un parcours « promotionnel » itinérant depuis bon nombre de mois déjà, les « fresques » photographiques constituant l’essentiel de son travail ces dernière années gagnent à être vues dans leur format d’origine.
Ce n’est donc qu’au prix excessif d’un billet d’entrée à 10€ (quand même) qu’il sera possible, enfin, d’appréhender dans toutes leurs dimensions « cartonesques » quelques unes des fameuses, volumineuses et clinquantes compositions (Holy War, Decadence : The Insufficiency of All Things Attainable …) dont le malin photographe s’est fait le spécialiste sans grand frais (et ce dans tous les sens du terme).
On préfèrera donc s’attarder sur l’une des pièces maitresses de cette rétrospective écrémée (seul un catalogue fort dispendieux permet de se faire une réelle idée de la somme et de la qualité du travail de cet acharné), infime partie d’un ensemble en fait composé de nombreux clichés extrêmement complexes : Deluge. 


Pas toujours très subtile mais picturalement bluffante, comme la plupart des œuvres exposées, on pourra également s’extasier devant une succession d’hommages « christiques » où stars et modèles se prêtent aux jeux de rôles imposés par des thèmes souvent pertinents.


Au centre de ce parcours dédié aux grands formats, un petit bijoux d’ironie qui pourrait à lui seul faire l’objet d’un accrochage spécifique : Recollections in America. Une série réalisée à partir de clichés datant des années 70, représentant des regroupements familiaux ou amicaux (fêtes, réunions) dont le contexte est transformé par l’insertion parfaitement invisible d’objets et de personnages.
C’est presque là que tout le talent de l’artiste se révèle, dans cette force d’analyse humoristique et forcément grinçante de la classe moyenne américaine à travers ses propres valeurs. Un must !


Publié par
rupert
Libellés :
Expos
2
commentaires
![]()
mardi 17 mars 2009
LOIN DE LA TERRE BRÛLÉE
 Scénariste inspiré de la plupart des films d’ Inarritu (dont les excellents Amours chiennes, 21 grammes,et le plus convenu Babel, en forme de redite), Guillermo Arriaga signe enfin, avec The Burning Plain, sa première réalisation.
Scénariste inspiré de la plupart des films d’ Inarritu (dont les excellents Amours chiennes, 21 grammes,et le plus convenu Babel, en forme de redite), Guillermo Arriaga signe enfin, avec The Burning Plain, sa première réalisation.
Gâté par un casting féminin de rêve qui lui a permis, à n’en pas douter, de boucler son budget, il se contente de reprendre les (grosses) ficelles d’un principe qui a, un temps, fait sa renommée (le puzzle narratif), mais dont la mécanique ultra prévisible ne surprend plus personne.
Avec une bonne longueur d’avance sur tous les personnages du film, le spectateur frustré s’accroche à une distribution sans faille mais qui méritait mieux. La jeune Jennifer Lawrence, une découverte, est sans aucun doute promise à une belle carrière et la belle Charlize Théron joue à merveille le rôle pas assez trouble d’une femme rattrapée par son passé.
Mais c’est la très charnelle Kim Basinger qui, comparable au bon vin qui se bonifie avec le temps, l’emporte haut la main dans ce jeu de faux chassés-croisés temporels et géographiques. Une prestation sensible et sensuelle, toute en retenue, qui mérite à elle seule qu’on aille jusqu’au bout de cette escapade mexicaine à la photographie soignée mais à l’intrigue éventée (déjà le titre français). Au final, la déception n’en est que plus grande …
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
1 commentaires
![]()
samedi 14 mars 2009
HARVEY MILK
 Les années 70 à San Francisco : en changeant les mentalités et en favorisant la coopération entre les minorités sociales et ethniques, Harvey Milk devient le premier homosexuel militant engagé à accéder à des fonctions officielles en Californie.
Les années 70 à San Francisco : en changeant les mentalités et en favorisant la coopération entre les minorités sociales et ethniques, Harvey Milk devient le premier homosexuel militant engagé à accéder à des fonctions officielles en Californie.
S’appuyant fidèlement sur le scénario plutôt radical de Dustin Lance Black, Gus Van Sant, presque à l’image du personnage passionné mais investi dont il dresse en partie le portrait, ne se laisse jamais déborder par les drames intimes qui surgissent au fil d’un parcours que l’engagement prédomine.
C’est la principale leçon de cette formidable biographie, à travers laquelle le cinéaste en profite pour raconter, à la manière d'un documentaire, les déboires d’une Amérique alors partagée par son désir d’émancipation et un puritanisme implacable, dont la grande réussite du film est de nous rappeler qu’il est encore d’une brûlante actualité. Et dans ce choix décisif à couvrir uniquement la période allant de l’entrée en politique d’Harvey Milk jusqu’à son assassinat (8 ans en tout et pour tout), Van Sant et surtout Black (intransigeant) donnent véritablement toute la mesure de l’implication de l’homme dans son combat, essentiel, vital, pas exempt d’erreurs ni de faux pas, et donc éminemment humain.
C’est ce même choix agrémenté de passionnantes images d’archives qui justifie les parti pris narratifs et esthétiques (une belle référence à Hockney) d’un récit qui ne s’appesanti jamais sur les idéaux sacrifiés d’une vie privée à peine esquissée, pour mieux se concentrer sur sa véritable raison d’être : la lutte incessante pour la tolérance, le respect.
Magistral dans un registre délicat, Sean Penn est sidérant de vérité. Il se fond intégralement dans la peau de Milk et emporte avec lui une distribution parfaite (en première ligne Josh Brolin, James Franco et Emile Hirsch) qui s’oublie totalement dans une interprétation en tout point investie. Une œuvre militante, importante, et accomplie. Un film essentiel !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
8
commentaires
![]()
mercredi 11 mars 2009
WATCHMEN
 De BD, que dis-je, de roman graphique réputé inadaptable, Watchmen – Les gardiens s’est bien vite transformé au cours de ces dernières années en buzz internet incroyable auquel, à des degrés de fiabilité divers, de nombreux réalisateurs, et pas des moindres, ont été plus ou moins associés.
De BD, que dis-je, de roman graphique réputé inadaptable, Watchmen – Les gardiens s’est bien vite transformé au cours de ces dernières années en buzz internet incroyable auquel, à des degrés de fiabilité divers, de nombreux réalisateurs, et pas des moindres, ont été plus ou moins associés.
En tête d’un palmarès que je ne listerai point, le talentueux - mais gigantesque « foireur » - Terry Gilliam a failli s’approprier le travail de l’excessif Alan Moore, auteur de bandes dessinées depuis longtemps convaincu de l’incapacité des studios à reproduire pertinemment une œuvre graphique dans son fond comme dans sa forme. Jusqu’à présent, force était de constater qu’il avait raison. L’un des comics les plus originaux de Moore, La ligue des gentlemans extraordinaires, fut un véritable fiasco artistique (retiré des studios après ce premier film, le réalisateur ne s’en est d’ailleurs toujours pas remis).
Quant au très stylisé V pour Vendetta, pas aussi mal fichu qu’on pouvait s’y attendre, il est loin d’atteindre les prétentions intellectuelles de l’ouvrage très abouti dont il est issu. Certes, Watchmen, le film, n’est pas un chef-d’œuvre.
Pourtant, on frôle l’objet culte. Qu’un réalisateur moyen, tendance « tâcheron » aux ambitions artistiques encore inhibés en ait été le metteur en scène n’y est pas pour rien ... au contraire.
En mettant de côté l’appétit créatif certain dont un cinéaste imaginatif, chevronné et accompli (tout le portrait de Gilliam) n’aurait pas manqué pour s’approprier totalement le projet, et en adaptant avec fidélité, voire dévotion (quasi religieuse, mais Zack Snyder est un vrai fan et ça se voit) les 396 pages nécessaires à l’élaboration d’une intrigue extrêmement complexe impliquant plusieurs périodes de l’Histoire « récente » des Etats-Unis, dans une version complètement révisée (les américains ont gagné la guerre du Vietnam et Nixon est élu Président pour la troisième fois consécutive ...), le réalisateur de 300 (pas forcément la preuve d’un grand talent) a presque humblement réussi à extirper ce qui faisait l’ossature, le sens, l’intérêt du bouquin de Moore et Gibbons (le dessinateur).
A découper son film comme s’il s’agissait des vignettes d’un comics, à passer (parfois en s’attardant même un peu trop) d’un personnage à l’autre, d’une situation à l’autre, tout en jouant des rythmes (plutôt contemplatif lorsqu’on côtoie Dr Manhattan, plutôt expéditif lorsqu’on suit les pérégrinations de Rorschach …), des couleurs incroyables (oui, très kitsch, mais elles sont autant d’indices qui complètent l’intrigue) et à traiter les effets spéciaux non pas comme des exploits de post production (style Lucas) mais comme les composantes naturelles d’un monde parallèle où vivent des êtres exceptionnels, Snyder reste complètement en phase avec le monument graphique qui prend enfin corps et vie sous nos yeux éblouis : génialement campés par des acteurs discrets aux physiques parfaitement identiques aux personnages de Gibbons, les héros (parfois super et parfois moins) ont une âme, un destin.
Un chouia simplifié (exit le personnage du Capitaine Métropolis, exit les intermèdes narratifs … qui devraient, paraît-il, composer les bonus du DVD à venir) et à peine modifié (pas besoin, l’action a beau se passer dans les années 80, on nage bizarrement en plein dans l’actualité politique de cette décennie) le scénario ne déçoit pas, n’atténue pas et se joue complètement des interdits et frustrations que bon nombre de studios auraient été susceptibles d’imposer à n’importe quel blockbuster (cf. : toutes les adaptations depuis le Batman de Burton, excepté The Dark Knight de Nolan). Mais justement, ce Watchmen si fidèle à son modèle imprimé fait-il vraiment figure de blockbuster ? Certainement pas ! Et c'est indéniablement sa plus grande qualité.
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
dimanche 8 mars 2009
LE PARC
 Créé en 1994 pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, Le Parc est une est une œuvre qui s’inscrit dans la veine des chorégraphies dites « néo-classiques » d’Angelin Preljocaj.
Créé en 1994 pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, Le Parc est une est une œuvre qui s’inscrit dans la veine des chorégraphies dites « néo-classiques » d’Angelin Preljocaj.
S’appuyant à la fois sur un classicisme structuré atypique et sur une partie du langage moderne et original qui caractérise certaines de ses créations, l’artiste d’origine albanaise y traite progressivement, avec humour, tendresse et mélancolie, d’espiègle badinerie, de jeux de séduction, du cheminement des passions et d’amour, bien sûr, dans un jardin français.
Ici aucun recour aux images de synthèse, aux nouvelles technologies dont Preljocaj, on le sait, est devenu depuis la fin des années 90 un brillant adepte. Sur une partition musicale principalement empruntée à Mozart (extraits de pièces pour cordes et de concertos - sublimes – pour pianos) formidablement complétée par des créations sonores de Goran Vejvoda, le décor massif (arbres géométriques gigantesques sur ciel changeant) mais étonnamment mouvant de Thierry Leproust, participe de ces chorégraphies à la fois inventives, ludiques, répétitives puis sensuelles et éminemment touchantes dont, actuellement à Garnier, les étoiles Delphine Moussin et Yann Bridard sont (entre autres) les deux protagonistes principaux.
Un hommage moderne, intelligent, vivifiant au Siècle des Lumières (coup de chapeau à celles de Jacques Châtelet), à la beauté rythmique des corps superbement costumés (beau travail d’Hervé Pierre) dans l’expression et l’exaltation des sentiments amoureux. Un spectacle de tous les sens, exceptionnel et très émouvant.
Ci-dessous : Abandon, interprété en 1999 par Isabelle Guérin et Laurent Hilaire (Adajio du Concerto pour piano n°23 – K. 488)
Publié par
rupert
Libellés :
Scènes
0
commentaires
![]()
mercredi 4 mars 2009
THE WRESTLER
 Darren Aronofsky est de ces réalisateurs dont j’ai pour (inconditionnelle) habitude d’apprécier la palette narrative et l’esthétisme mis en œuvre pour « emporter » les spectateurs dans des univers toujours très personnels ... qualités en effet incontestables de ses trois premiers films : Pi, Requiem for a Dream (l’adaptation choc du roman d’Hubert Selby) et même, oui même, l’étrange O.V.N.I. cinématographique qu’est The Fountain.
Darren Aronofsky est de ces réalisateurs dont j’ai pour (inconditionnelle) habitude d’apprécier la palette narrative et l’esthétisme mis en œuvre pour « emporter » les spectateurs dans des univers toujours très personnels ... qualités en effet incontestables de ses trois premiers films : Pi, Requiem for a Dream (l’adaptation choc du roman d’Hubert Selby) et même, oui même, l’étrange O.V.N.I. cinématographique qu’est The Fountain.
Dans le quatrième, il a fait table rase de toutes considérations artistiques pour coller au mieux de la réalité des choses, même des plus trash. Caméra à l’épaule, image documentaire (enfin presque !), The Wrestler plonge dans le quotidien triste d’un homme à la ramasse, jusqu'à sa déchéance. S’accrochant, comme à une bouée de sauvetage, à une jolie stripteaseuse en fin de carrière (la touchante Marisa Tomei) et à cette fille (Evan Rachel Wood, un talent qui monte) dont il n’a jamais pris le temps de s’occuper, Randy, le catcheur du titre, se débat dans les méandres qu’une vie de solitude accentuée par un physique au bout du rouleau ont fini par complètement absorber, et qui, résolu, tente absolument de « renaitre ».
Alors forcément, rien de tel qu’une star déchue pour interpréter avec force symbolisme et totale identification, la résurrection de ce Bélier (The Ram en V.O.) en quête de lui-même. Dans le rôle, difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Rourke. Il est ce personnage totalement émouvant avec lequel, évidemment le parallèle s’impose. En s’appuyant sur les failles, les blessures et le parcours de son acteur principal, Aronofsky a fait LE choix, celui qui a permis sans aucun doute à The Wrestler d’être primé notamment à Venise. Sauf qu’à trop d’identification on en oublie presque que ce Randy existe pour lui-même et c’est finalement à LA star au parcours chaotique que se retrouve véritablement confronté le spectateur.
C’est à la fois le plus gros défaut mais aussi, il faut le reconnaître, la plus grande qualité de ce film très émouvant qui peine pourtant, parfois, à se démarquer de ses incontournables références (!). Pour le coup, c’est juste un peu dommage ...
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
lundi 2 mars 2009
LA TRAHISON
 Thomas et Paul sont les meilleurs amis du monde.
Thomas et Paul sont les meilleurs amis du monde.
De vrais frères. Nés le même jour (celui très symbolique d’août 45 où les Etats-Unis ont lâché la première bombe atomique sur Hiroshima), mais pas dans la même ville, ils grandissent ensemble à Natchez, sur les rives du Mississipi. Là, inséparables dans la joie, dans les plaisirs d’un quotidien presque ordinaire, comme dans la douleur, ils grandissent dévastés par l’absence d’un père, pour l’un, d’un frère, pour l’autre.
On les expose au racisme le plus radical (celui du sud), ils fréquentent l’église, puis découvrent la politique, la télévision et … l’amour, bien sûr. Bien sûr ! Et c’est à cette découverte, très tardive, dans ce roman simple à l’écriture extrêmement fluide (tellement qu’elle en est parfois déconcertante), que la trahison du titre révélateur sera inévitablement liée.
Pas besoin d’être finaud pour comprendre bien avant la première moitié d’un livre au style si délicat, si sensible qu’il en devient rapidement appétissant, aux chapitres si riches et à la fois si courts qu’on en devient vite gourmand, à quoi tiendra la fin immanquablement tragique de cette chronique intimiste et touchante.
Celle, singulière, de ces deux personnages, mais également celle, en filigrane et autrement plus complexe, d’une Amérique faussement idéalisée par la représentation de ce tableau d’Hopper, High Road, en couverture.
Une Amérique d’Histoire (Eisenhower, l’assassinat de Kennedy, la disparition de Marylin, celle de Luther King, les batailles idéologiques, l’embrasement des universités…) que le fardeau de deux guerres (Corée, Vietnam) plus celui du McCarthysme viendra entacher de drames tels que cette fameuse trahison dont le narrateur, mais avant lui son fidèle ami, ne se relèveront pas.
Alors ce dernier Besson (son 10ème en huit ans) n’est pas un grand livre, certes, mais il est de ces bouquins qui vous laissent, et pour longtemps, de drôles de traces indélébiles … de ces images si bien (d)écrites qu’elles font les bons romans.
Publié par
rupert
Libellés :
Pages
0
commentaires
![]()
dimanche 1 mars 2009
LA PLAGE
 Dans le sud, je ne reviens presque jamais sans honorer de quelques pas les rivages désertés qui, en dehors des périodes estivales, retrouvent le calme et la sérénité qu'avaient certaines matinées d’été dans mon enfance.
Dans le sud, je ne reviens presque jamais sans honorer de quelques pas les rivages désertés qui, en dehors des périodes estivales, retrouvent le calme et la sérénité qu'avaient certaines matinées d’été dans mon enfance.
A cette époque un peu lointaine, où la région n’était pas encore totalement défigurée par les hordes de promoteurs immobiliers auxquels des municipalités, peu regardantes sur leurs prétentions architecturales et plus concernées par le développement éventuel du bassin d’emploi que par le respect de l’environnement, sacrifièrent irréversiblement la côte méditerranéenne, les dunes qu’un vent marin venait fouetter et déplacer s’étendaient, me semblait-il, à l’infini et pour toujours.
La voiture empruntait alors une petite route goudronnée que le sable balayait, recouvrait, jusqu’à cette plage où seules quelques familles, attentives à la puissance d’un soleil qui ne tarderait pas à devenir insupportable, prenaient déjà du bon temps. Du temps, j’en ai passé moi aussi sur cette plage, cette jetée, et dans l’eau à regarder, car trop petit, mes sœurs plonger (les délicieux couteaux n’étaient encore pas si rares … aujourd’hui on n’en trouve même plus chez un bon poissonnier), et plus tard aux côtés d’une grand-mère attentive qui passait des heures à faire son crochet sous le parasol coloré …
Les souvenirs de ces époques (il y en eu plusieurs) se rappellent toujours nombreux, riches en détails fidèles qui me les rendent chers et vivants. Mais voilà, la plage désormais souillée de ces lointains étés ne m’attire plus que pour regarder, l’hiver, le soleil se coucher. Alors qu’il disparaît, je dédie sans regret à ces absents qui comptent et qui ne reviendront pas, quelques tendres pensées …
Publié par
rupert
Libellés :
Ensemble
7
commentaires
![]()