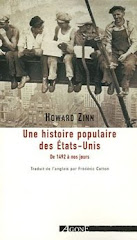Dans les bacs, toujours : à venir le 23 mars, le prochain album du célèbre duo électronique britannique, les Pet Shop Boys.
Dans les bacs, toujours : à venir le 23 mars, le prochain album du célèbre duo électronique britannique, les Pet Shop Boys.
Capables du meilleur (Behaviour, Bilingual, Nightlife, et surtout Release) comme du pire (le monumental flop artistique de Fundamental, leur dernier opus), les deux camarades se sont cette fois-ci adjoints les services de Xenomania, la boîte de prod de Brian Higgins qui a déjà fait le succès de groupes pop tels que les Sugababes (bon, pas forcément une référence).
Une collaboration parmi d’autres, notamment celles de Johnny Marr (ex-Smith) et de l’arrangeur Owen Pallett (Arcade Fire), qui permettrait éventuellement à nos fidèles comparses de renouer avec le succès qui semble les avoir un peu abandonné ces dernières années, leur dispensable live Concrete, n’ayant pas atteint des scores forcément très honorables.
Espérons donc que ce Yes, 10ème album très attendu, soit à l’image (dans le fond comme dans la forme) de l’excellent single qui le précèdera de quelques jours, Love Etc., superbement mis en images (un jeu videographique) par le génial Han Hoogerbrugge, dont je vous invite à visiter le site d’urgence !
jeudi 26 février 2009
YES !
Publié par
rupert
Libellés :
Sonos
0
commentaires
![]()
mercredi 25 février 2009
CONTROLLING CROWDS
 Plus qu’un mois avant l’arrivée dans les bacs du tout nouvel opus d’Archive, collectif britannique évolutif qui n’a jamais cessé depuis sa formation de se métamorphoser au gré des styles, des genres - du trip-hop de Londinium au rock progressif de Noise en passant par l’électro de Take My Head - qu’il intercepte et s’approprie, presque toujours avec talent.
Plus qu’un mois avant l’arrivée dans les bacs du tout nouvel opus d’Archive, collectif britannique évolutif qui n’a jamais cessé depuis sa formation de se métamorphoser au gré des styles, des genres - du trip-hop de Londinium au rock progressif de Noise en passant par l’électro de Take My Head - qu’il intercepte et s’approprie, presque toujours avec talent.
Porté par le très identifiable single Bullets, avec au chant le retour de Pollard Berrier (membre du groupe vocal Bauchklang), et à l’image la bande d’Hello Charlie (clip glacial très cinématographique), Controlling Crowds (c’est d’actualité) s’annonce d’ores et déjà comme un album transgenre, pluriculturel, qui tentera d’investir les territoires aussi différents que ceux des Pink Floyd, de Prodigy ou encore ceux de Massive Attack. Au programme, hip-hop, rap distordant, pop, ballade électronique et rock hypnotique virant psychédélique ... constitueront le ciment d’une œuvre qui pourrait être considérée à la fois comme une synthèse fidèle et un renouvellement appréciable, soutenu par les voix de Dave Pen, Rosko John et bien sûr Maria Q ...
Autant dire que Darius Keeler et Danny griffiths, les deux co-fondateurs d’Archive ont mis les petits plats dans les grands pour ce retour très attendu et qui devra faire aussi bien sinon mieux que son prédécesseur, le fameux et très réussi Lights, une référence à l’époque unanimement saluée.
Réponse définitive le 30 mars.
Publié par
rupert
Libellés :
Sonos
1 commentaires
![]()
jeudi 19 février 2009
LE CODE A CHANGE
 Et c'est tant mieux, car il n'y a rien à sauver de ce navet calamiteux signé Madame Thompson : c’est poisseux, c'est mondain, mal écrit, mal filmé, mal dirigé et ... très très mal joué.
Et c'est tant mieux, car il n'y a rien à sauver de ce navet calamiteux signé Madame Thompson : c’est poisseux, c'est mondain, mal écrit, mal filmé, mal dirigé et ... très très mal joué.
A plein régime Karine Viard en fait des tonnes (!), Dany Boon reste (définitivement ?) pathétique, Christopher Thompson (fils de Madame) confirme son absence de charisme, Emmanuelle Seigner fait juste pitié, Patrick Chesnais semble égaré, Blanca Li (une copine ?) inappropriée, etc etc ... quant à Marina Foïs (dont vous savez tout le bien que je pense), elle n’est ni à sa place, ni à son aise dans le rôle d’une gynéco paralytique aux côtés d’un Patrick Bruel cancérologue (ben voyons) invariablement égal à lui-même (je précise ?) ...
Un scénario médiocre, sans inspiration mais plein de mauvaises idées, aussi plat qu’un encéphalogramme débranché, « ponctué » de dialogues pour la plupart douteux, doublés de calembours vaseux, qui sentent (fort) les séances d’écriture (hum) au cours desquelles on a visiblement privilégié l’autosatisfaction primaire et le parisianisme faussement assumé ...
Côté réalisation, des images criardes où les gros plans abominables s’éternisent sur les visages figés d’un casting accablant, désincarné et qu’aucune indulgence ne saurait, de toutes façons, améliorer ... rien à faire, je réitère, tout est mauvais.
Alors moi, dans ces cas là, je quitte la salle ! (c’est dit, c’est fait)
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
DANS LE DOUTE ...
 ... mettre à mal les certitudes ! S’appuyant sur une réalisation aussi rigide et stricte que l’univers presque carcéral dont il est ici question, Doubt ressemble presque, dans l’idée, à ce qui pourrait s’apparenter au meilleur du genre. Pourtant ...
... mettre à mal les certitudes ! S’appuyant sur une réalisation aussi rigide et stricte que l’univers presque carcéral dont il est ici question, Doubt ressemble presque, dans l’idée, à ce qui pourrait s’apparenter au meilleur du genre. Pourtant ...
En adaptant et en dirigeant lui-même la pièce qu’il avait créée, John Patrick Shanley ne fait pas preuve de grande originalité cinématographique. Et, il faut le reconnaître, le classicisme est au premier plan de ce huis clos un tantinet poussiéreux pas tout à fait exempt de clichés, de ceux dont tout amateur de drame psychologique aimerait aujourd’hui être définitivement épargné.
Car même s’il aborde et mixe des thèmes aussi risqués que le racisme, la pédophilie, l’homosexualité et l’intolérance dans le milieu éducatif catholique (aux Etats-Unis dans les années 60 !) le film ne franchit jamais les limites ennuyeuses du « respectable », de ce qu’il sera convenu de traiter avant tout par l’implicite.
Sauf une fois, lors de la confrontation magistrale entre Meryl Streep (en stupéfiante et très sévère directrice d’école) et la très touchante Viola Davis (dans le rôle d’une mère désemparée), certainement le plus beau face à face du film qui, sans doute possible, doit sa petite part de réussite à une interprétation de très haut niveau. Du coup, même la prestation de Philip Seymour Hoffman (un peu en deçà) semble pâtir de cette mise en scène sclérosée, dont il semblerait que l’auteur ne soit finalement pas le mieux placé pour traiter avec le recul nécessaire (particulièrement lors de la dernière scène) un sujet auquel il a déjà été certainement trop confronté ...
C’est bien dommage mais, qu’on se rassure, ça n’empêche pas d’y trouver malgré tout un certain intérêt.
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
dimanche 15 février 2009
ROMA ANTICA
 Un pied dans l’Histoire ! Quoi de plus extraordinaire, de plus étonnant que de fouler des siècles et des siècles plus tard, de nos pas de touristes curieux parfois inattentifs mais toujours subjugués (et comment ne pas l’être), les rues pavées, les temples et les monuments (parfois dégradés) qui sont le cœur même de la romanité, sa représentativité inaffectée.
Un pied dans l’Histoire ! Quoi de plus extraordinaire, de plus étonnant que de fouler des siècles et des siècles plus tard, de nos pas de touristes curieux parfois inattentifs mais toujours subjugués (et comment ne pas l’être), les rues pavées, les temples et les monuments (parfois dégradés) qui sont le cœur même de la romanité, sa représentativité inaffectée.
Les lieux les plus traditionnels de la culture romaine, du Capitole au Colisée, maintes et maintes fois imaginés, sont là intacts ou presque (ou presque pas), qu’il est possible d’approcher, de pénétrer et « d’ausculter » à sa guise enfin, comme les vestiges réels d’incroyables souvenirs cinématographiques, ceux d’un Cinecittà au passé grandiose et aujourd’hui sous estimé. Manque de moyens oblige (il en faut de l’argent pour dévoiler et veiller à cette multiplicité de trésors ensevelis par les tremblements de terre, les ravages des hommes et du temps), aujourd’hui comme hier, Rome, l’Italie et ses politiques ont bien du mal à s’occuper des ruines magnifiques qui font pourtant venir à eux des hordes de visiteurs avides de culture et de sens. Magnifique et … désolant.

 A l’est du Forum antique, se trouve l’extraordinaire symbole de la Rome impériale, le Colisée (amphitheatrum flavium), plus grand amphithéâtre elliptique jamais construit dans l’Empire Romain, qui fût durant 500 ans le lieu mémorable des plus sanglants combats entre gladiateurs, les fameux jeux dont Ridley Scott nous donne un excellent aperçu dans son film Gladiator (la reconstitution du Colisée y est exceptionnelle), mais également d’autres spectacles tels des simulacres de batailles navales ou des chasses d’animaux sauvages …
A l’est du Forum antique, se trouve l’extraordinaire symbole de la Rome impériale, le Colisée (amphitheatrum flavium), plus grand amphithéâtre elliptique jamais construit dans l’Empire Romain, qui fût durant 500 ans le lieu mémorable des plus sanglants combats entre gladiateurs, les fameux jeux dont Ridley Scott nous donne un excellent aperçu dans son film Gladiator (la reconstitution du Colisée y est exceptionnelle), mais également d’autres spectacles tels des simulacres de batailles navales ou des chasses d’animaux sauvages … 
Publié par
rupert
Libellés :
Ailleurs
4
commentaires
![]()
vendredi 13 février 2009
THE CURIOUS CASE
 Une merveille ! Au départ, une très courte nouvelle de F. Scott Fitzgerald, au final un film d’une époustouflante splendeur. Parce qu’il faut le dire, Benjamin Button est avant tout l’un des plus fastueux et vibrant hommage qu’un réalisateur de la génération de Fincher ait jamais rendu à l’histoire du cinéma.
Une merveille ! Au départ, une très courte nouvelle de F. Scott Fitzgerald, au final un film d’une époustouflante splendeur. Parce qu’il faut le dire, Benjamin Button est avant tout l’un des plus fastueux et vibrant hommage qu’un réalisateur de la génération de Fincher ait jamais rendu à l’histoire du cinéma.
Tout, de la mise en scène à la photographie (coup de chapeau à Claudio Miranda), des décors aux costumes en passant par la musique (parfaite d’Alexandre Desplat) jusqu’aux pittoresques détails de certaines situations parfois très cocasses, parfois très nostalgiques, y est prétexte pour sublimer stylistiquement parlant les grandes périodes Hollywoodiennes, mais pas que : le muet des frères lumières, les récits d’aventures dignes d’un John Huston, les atmosphères romantiques à l’esthétisme inouï que n’aurait pas renié un Vincente Minelli ou encore les comédies dramatiques américaines des 70’s ... le film tout entier et par bien des aspects (notamment en matière d’effets numériques, une véritable prouesse) constitue le plus efficace et sensible témoignage qu’il ait été donné de voir sur l’évolution, d’un point de vue « poétique » (certains diront naïf), de l’industrie du 7ème Art.
Jugé inadaptable pendant de très longues années, il a fallu toute l’ingéniosité des deux producteurs pour finalement rassembler autour de ce projet artistiquement très ambitieux le scénariste Eric Roth, ainsi que le réalisateur et l’acteur principal de Se7en.
Première bonne idée : tout en s’appuyant sur le postulat de départ de l’histoire originale, Roth en a abandonné le fil narratif pour en modifier sensiblement les composantes principales et le rendre plus « réaliste ».
Dans la nouvelle de Fiztgerald, Button nait vieillard adulte avec une longue barbe grise (!). Beaucoup trop grand pour rester dans son berceau, il parle déjà avec l’expérience des gens d’un certain âge et bougonne lorsqu’on lui impose de porter des habits de petit garçon. Nanti, il reprend l’entreprise familiale, la fait prospérer et épouse une femme dont il aura un fils. Tous deux finiront par le détester, avant de le voir sombrer dans l’inconscience totale du nourrisson, puis disparaître dans le néant.
Dans le film, le vieillard est un vrai nourrisson souffrant d’arthrite et susceptible de mourir immédiatement. Abandonné à sa naissance, il est recueilli par la gouvernante noire d’une maison de retraite (une idée formidable qui donne au film certaines de ses séquences les plus touchantes). Il évolue donc, dès son plus jeune âge, parmi les personnes âgées, avant de tomber amoureux d’une fillette dont la grand-mère est une des pensionnaires du lieu. Il passera pratiquement toute sa vie en solitaire, à découvrir d’autres et d’autres ailleurs, à croiser cet amour sans jamais pouvoir le concrétiser vraiment, ni vraiment longtemps.
Alors que l’écriture de Fitzgerald exploite une veine cynique et assez cabotine, la proposition de Roth s’appuie sur l’apprentissage douloureux d’une vie d’errance, de solitude et de fatalité.
D’où une terrifiante impression de tristesse et de mélancolie au fur et à mesure que les personnages apparaissent, s’installent puis disparaissent, une réflexion majeure sur l’apprentissage de la perte qui conduit à ce constat totalement à l’encontre des codes systématiques du cinéma romantique destiné au plus grand nombre.
C’est là qu’on retrouve tout le savoir-faire (mûrissant) de Fincher et sa prédilection, qu’il s’agisse de commandes (Alien3, The Game ...) ou d’adaptations (Fight Club, Zodiac ...), pour des sujets forts, limites, aux lectures multiples. De ces projets qui lui permettent de privilégier coûte que coûte sa dimension d’Auteur et de s’approprier un scénario comportant, comme celui-ci, quelques grandes similitudes avec celui d’un Forrest Gump (dont Roth était déjà le scénariste), mais en déjouant astucieusement les pièges d’une redite éventuelle et en dirigeant son histoire vers d’autres enjeux, comparables à ceux d’un cheminement personnel très intime.
Une maturité enfin assumée qui donnera à n’en pas douter à ce Curious Case of Benjamin Button l’étoffe d’un classique, de ceux qui se dévoilent et s’apprécient au rythme lent et douloureux des histoires d’amour, des histoires de vies ... un très GRAND film.
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
lundi 9 février 2009
GUERILLA
 Deuxième partie du même film, sortie à quelques semaines d’intervalle, faisant suite aux péripéties cubaines de l’emblématique figure de la révolution, Che : Guerilla surpasse sans peine sa première moitié.
Deuxième partie du même film, sortie à quelques semaines d’intervalle, faisant suite aux péripéties cubaines de l’emblématique figure de la révolution, Che : Guerilla surpasse sans peine sa première moitié.
Plus complexe, énergique et surtout plus inspirée, la réalisation de Soderbergh trouve sans peine ses marques et donnent à ce second volet l’indispensable tension qui manquait cruellement à l’Argentin.
Alors que sa gloire est au plus haut, Ernesto Guevara quitte Cuba et son camarade Castro pour disparaître et revenir, méconnaissable, en Bolivie où, avec un petit groupe de rebelles tenaces et fidèles, il tente de déclencher sa grande Révolution Latino-américaine.
Véritable ode à l’icône universelle qu’est le Che (ce qui peut être également et légitimement assimilé à un reproche), c’est cette campagne bolivienne d’une intensité dramatique formidable qui donne toute son ampleur à (une partie de) la personnalité idéaliste de l’homme, à son sens du sacrifice.
Enfonçant le clou en nous dévoilant le personnage de manière presque « christique », Soderbergh et son (grand) acteur Del Toro, dont il est indiscutable, qu’on aime ou pas le film, qu’il est son plus grand rôle, pêchent malgré tout par manque de didactisme.
Certainement un peu trop longue mais de toutes façons captivante jusqu’à sa chute, grand moment de cinéma et d’histoire qu’on le veuille ou non, Guerilla conclut en mode majeur une œuvre phare inégale et discutable mais qui pourrait servir d’exemple à grand nombre de biographies souvent moins inspirées, passionnées et passionnantes. Une bonne leçon.
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
3
commentaires
![]()
SOPHIE RISTELHUEBER
 En marge de l’exposition phare dédiée au photographe Robert Franck, Un regard étranger, le Jeu de Paume présente jusqu'au 22 mars prochain la première grande rétrospective française consacrée à Sophie Ristelhueber.
En marge de l’exposition phare dédiée au photographe Robert Franck, Un regard étranger, le Jeu de Paume présente jusqu'au 22 mars prochain la première grande rétrospective française consacrée à Sophie Ristelhueber.
Tout un étage ! Il n’en fallait pas moins pour dévoiler à un public amateur d’images, confronté à l’une des meilleures programmations de la capitale, le travail extraordinaire d’une artiste dont les débuts dans la photographie ont été marqué par ses collaborations avec les maîtres Doisneau et Depardon. Ici, s’imposant comme rarement dans la sobriété d’un espace parfois trop rigide, dévoilant par de simples astuces les multiples respirations, ouvertures et dialogues qu’il permet avec le jardin extérieur, le travail de Ristelhueber n’aurait pu être plus mis en valeur.
En son centre, point d’orgue d’une présentation implacable mais forte d’une sensibilité rare, Fait, une magnifique série « damier » gigantesque, en couleur et en gris réalisée en 1991 dans le désert du Koweït, au lendemain de la première guerre du golfe. Brouillant toute notion d’échelle, les 71 tirages qui la composent évoquent autant les troublantes scarifications sur des corps improbables que des œuvres abstraites. 

Autour, dans les salles aérées, se côtoient les paysages dévastés de Beyrouth (Beyrouth, Photographies, 1984), et des images de corps suturés, un hommage fort et vibrant aux victimes du conflits serbo-croate (Every One, 1994), des clichés encadrés et extrêmement touchants de la maison de famille, pris à hauteur d’enfant, (Vulaines, 1989), et d’autres immenses, simplement collés sur le mur, inspirés par un attentat à la voiture piégée en Irak (Eleven Blowups, 2006) …


C'est un engagement, une démarche personnelle totale, sans concession, mais toujours empreints de sens et de délicatesse. Des histoires, des ruines, et des cicatrices, celles des corps, celles des territoires, … un regard pur, sans interventionnisme directif.
Un parti pris qui, au final, en appelle à la réflexion plus qu’à la contemplation, mais qui n’omet jamais la qualité et la puissance des lignes, ni cette confrontation indispensable à la matière, dont on sait qu’elles permettent instantanément d’ouvrir le dialogue avec l’œuvre. Une découverte !
Publié par
rupert
Libellés :
Expos
0
commentaires
![]()
vendredi 6 février 2009
SOUS LE CHARME
 Une réalisatrice souhaite tourner un documentaire vérité sur les actrices, en y incorporant des bout de clips chantés censés traduire l’inconscient de chacune d’elle ... Certes, si le concept est séduisant, on ne peut s’empêcher de penser que l'entreprise est plutôt casse-gueule pour qui ne maitriserait pas forcément l’art du second degré et la notion de distance vis-à-vis d’un tel sujet. Incontestablement, Maïwenn réussit avec son Bal des actrices le véritable tour de force qui consiste à balayer toutes les idées reçues en traitant avec une légèreté bienvenue et une fraicheur indispensable cet univers de faux-semblants aux limites de la complaisance ... assumée ! Et c’est avec un régal sans pareil qu’on admire les portraits inattendus de ses charmeuses irrésistibles qui se jouent insolemment de leur image, avec plaisir, émotion, et évidemment un brin d’espièglerie (à noter les mises en musiques de Biolay, Lavoine, Starr, Anaïs et j’en passe ...).
Une réalisatrice souhaite tourner un documentaire vérité sur les actrices, en y incorporant des bout de clips chantés censés traduire l’inconscient de chacune d’elle ... Certes, si le concept est séduisant, on ne peut s’empêcher de penser que l'entreprise est plutôt casse-gueule pour qui ne maitriserait pas forcément l’art du second degré et la notion de distance vis-à-vis d’un tel sujet. Incontestablement, Maïwenn réussit avec son Bal des actrices le véritable tour de force qui consiste à balayer toutes les idées reçues en traitant avec une légèreté bienvenue et une fraicheur indispensable cet univers de faux-semblants aux limites de la complaisance ... assumée ! Et c’est avec un régal sans pareil qu’on admire les portraits inattendus de ses charmeuses irrésistibles qui se jouent insolemment de leur image, avec plaisir, émotion, et évidemment un brin d’espièglerie (à noter les mises en musiques de Biolay, Lavoine, Starr, Anaïs et j’en passe ...).
Pourtant, si le casting, alléchant, peut s’avérer surprenant et tentant, il est aussi le principal défaut de cette succession de « sketches » inégaux, permettant aux convives (nous) de porter un jugement forcément partial sur les prestations de chacune : si la majorité d’entre elles (Karine Viard, Marina Foïs, Linh Dan Pham, Jeanne Balibar et Romane Bohringer), réussissent haut la main et dans des styles très différents leur examen de passage avec mention, d’autres (Julie Depardieu, pourtant très touchante, Charlotte Rampling, en pointillets) pâtissent considérablement d’une écriture un peu faiblarde, quand au contraire certaines (Mélanie Doutey, Muriel Robin, Estelle Lefébure) ne sont carrément pas à la hauteur des ambitions du projet.
Mais, passées ces (fausses) réserves, une réalisation parfois maladroite, quelques menues longueurs et les regrettables absences de frileuses décevantes (étonnamment Catherine Deneuve et Mathilda May, évidemment Isabelle Adjani et Sophie Marceau, heureusement Monica Bellucci ...), le plaisir sincère est communicatif. Les hommes, complices, ne sont pas en reste et Joey Starr, inattendu et bienvenu, apporte ce qu’il faut de distance, d’humour et de tendresse au fil conducteur qu’une bien jolie Maïwenn, culottée et manipulatrice, s’amuse à (dé)dramatiser.
Une curiosité et une réussite (!) dans son genre ...
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
6
commentaires
![]()
mercredi 4 février 2009
SHINING LIGHT
 Ma chanson du moment (entendez « la chanson que j’écoute en boucle ») ne vous surprendra qu’à moitié puisqu’il s’agit du tout nouveau single d’Annie Lennox (ben oui, encore !).
Ma chanson du moment (entendez « la chanson que j’écoute en boucle ») ne vous surprendra qu’à moitié puisqu’il s’agit du tout nouveau single d’Annie Lennox (ben oui, encore !).
Shining Light, reprise pop d’une ballade rock du groupe Ash, permet d’illustrer avec brio, un brin de nostalgie, mais aussi d’autodérision et donc de bonne humeur, les 17 ans de carrière solo de la célèbre écossaise.
The Annie Lennox Collection, dont la sortie est prévue courant mars, sera principalement constituée d’extraits majeurs des quatre albums de la dame (Diva, Medusa, Bare et Songs of Mass Destruction) ainsi que d’un DVD comportant l’intégrale (ou presque) de ses clips. Y figure également un deuxième inédit, Pattern Of My Life, la cover d’une face B de Keane écrite par Tom Chaplin, qui ne devrait pas bénéficier d’édition promotionnelle.
Rien d’exceptionnel donc (quid de la chanson qui lui a valu son Oscar, de son duo avec Jimmy Cliff, de celui avec Al Green, de sa magnifique reprise de Cole Porter ? ...), mais quand on sait que la chanteuse passe le plus clair de son temps à promouvoir énergiquement la fondation créée par Nelson Mandela pour lutter contre le SIDA en Afrique, on peut concevoir qu’une compilation (un dû réclamée par Sony BMG lui permettant de clore son contrat avec la « maison de disques ») ne fasse pas partie des priorités d’une femme par ailleurs déjà très impliquée.
Le clip tout simple mais finement bourré de clins d’œil plutôt humoristiques (à Little Bird, à It’s Alright ... ou même à la période Tourists) est tout ce qu’il y a de plus sympa ! Hey Pépère, c’est pour toi !!!!!!!!
Publié par
rupert
Libellés :
Sonos
0
commentaires
![]()
mardi 3 février 2009
SLUMDOG
 Depuis qu’il a fait ses toutes premières armes sur grand écran, l’anglais Danny Boyle n’a pratiquement jamais cessé de traiter en long, en large et en travers (surtout en travers), des méfaits de l’argent sur ses contemporains.
Depuis qu’il a fait ses toutes premières armes sur grand écran, l’anglais Danny Boyle n’a pratiquement jamais cessé de traiter en long, en large et en travers (surtout en travers), des méfaits de l’argent sur ses contemporains.
Ainsi, de ce petit bijou d’humour noir qu’est Shallow Grave en 1994 jusqu’à ce Slumdog Millionaire qui fait actuellement un carton, en passant par Trainspotting et, bien entendu, l’anecdotique Millions, Boyle a toujours plus ou moins su tirer parti de scénarios sur lesquels d’autres, pourtant comme lui adeptes de l’esthétisme choc à tout prix, se seraient certainement cassés les dents.
Ici en adaptant assez peu fidèlement, par l’intermédiaire du scénariste Simon Beaufoy, le roman de l’écrivain indien Vikas Swarup, Les Fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devient milliardaire, le réalisateur britannique n’y est carrément pas allé par quatre chemins. S’appuyant sur un chef op des plus efficaces et une bande son techno-orientale à faire danser la terre entière, c’est à un véritable hommage punchy au grand Bollywood (toujours incapable de séduire les masses occidentales) qu’il se livre avec cette histoire finalement assez simpliste et qui tourne rapidement en rond. Mais bon!
A la fois émouvant, joyeux, drôle, trépidant, triste, tragique mais aussi romanesque, … le film l’emporte avant et par-dessus tout parce qu’il a une haute capacité à séduire de manière totalement émotionnelle et basiquement populaire tout en traitant, à sa manière un peu superficielle, des contradictions d’un pays et de son peuple en totale et perpétuelle mutation.
Confortablement installé au volant d’une intrigue manichéenne, qui n’en est d’ailleurs pas vraiment une, mais déroulant sincèrement et sans aucune baisse de rythme le fil de son histoire à dormir debout, Boyle inspiré par un casting pur jus (et fantastique) s’en donne à cœur joie avec une énergie et un bonheur non feints et franchement communicatifs.
Alors oui, on pourra aisément comparer l’ensemble à un grand patchwork d’aventures clinquantes et parfois un peu mièvres qu’un montage roublard sous amphétamines et une pellicule aux tonalités excessivement contrastées rapproche des kitcheries clipesques plus communes aux années 80, mais si Slumdog séduit autant qu’il agace (!), c’est justement parce qu’il se réfère, sans crainte d’être catalogué, à ce cinéma indien que nous autres avons encore trop de mal à apprécier pour ce qu’il est, et pour ce qu’il fait : un simple mais vrai moment de détente pluriculturelle sans profonde prétention intellectuelle ... et ça fait un bien fou !!!
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
4
commentaires
![]()