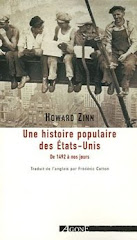... de tout !
Et pour le reste, si ça vous manque tant, prenez donc un bon livre ; peut-être pas le seul, mais un précieux remède pour combattre de front toute cette morosité, vos rendez-vous loupés, ces voyages reportés, leurs scénarios bâclés, des chanteurs déprimés ... et un vin bouchonné.
Euh ?
Si je vous le dis ...
jeudi 31 décembre 2009
BONNE ANNEE ...
Publié par
rupert
Libellés :
Blabla
2
commentaires
![]()
samedi 12 décembre 2009
ÓLAFUR ARNALDS
... en ces temps difficiles qui n'augurent rien de très positif (à moins que ce ne soit l'inverse ?), un peu de douceur, de chaleur, de quiétude.
Déjà, je me demande quels souvenirs je garderai de cette année qui se termine. Bah, nous verrons bien ... Vous avez senti ? L'hiver arrive.
Publié par
rupert
Libellés :
Blabla,
Sonos
2
commentaires
![]()
mardi 29 septembre 2009
THE RESISTANCE
 On appelle ça une volée de bois vert !
On appelle ça une volée de bois vert !
En proposant un album riche, aux sonorités somptueuses (pompeuses diront certains), qui brouille un peu plus les pistes en s’éparpillant pour le meilleur et parfois aussi l’un peu moins bon, Muse n’a pas choisi la facilité.
Se mettre à dos les critiques c’est une chose, déjà faite avec leur formidable Black Holes and Revelation, précédent opus qui donna lieu à une tournée géniale dont Haarp - l’album live - se fît l'écho lumineux.
Se mettre à dos ses propres fans, quand on sait avec quelle difficulté on vend des disques aujourd’hui, ç’en est une autre … que le groupe de Matthew Bellamy assume sans complexe, ni regret, comme l’influence incontestable du compositeur Sergeï Rachmaninov dont on constatera encore une fois (notamment dans le trypitique final Exogenesis) l’importance dans l’univers de plus en plus ouvert du trio anglais.
Ouvert, le mot n’est pas galvaudé dans le cadre de ce plat de Resistance tant attendu et qui surprend par son audace : quand les vocalises d’un Freddy Mercury (chapeau Bellamy) et ses guitares Reines (le grandiloquent United States of Eurasia ou le faste Guiding Light) voisinent avec le plus étonnants des titres R’n’B (l’inattendu Undisclosed Desires), forcément on devient accro ou on fait une indigestion. Je vais me mettre tout le monde à dos, mais voilà ... pour moi c’est un vrai régal !
Publié par
rupert
Libellés :
Sonos
0
commentaires
![]()
jeudi 17 septembre 2009
INGLORIOUS BASTERDS
 Cinéaste culte dont chaque projet fait s’enfler les rumeurs les plus folles, Tarantino a les moyens de prendre son temps.
Cinéaste culte dont chaque projet fait s’enfler les rumeurs les plus folles, Tarantino a les moyens de prendre son temps.
Il lui aura fallu 10 ans, pas moins, pour venir à bout d’un scénario plus coriace qu’à l’accoutumée, un western spaghetti mâtiné de film de guerre (à moins que ce soit l’inverse) avec lequel le réalisateur aura su prendre la distance, le recul qui caractérise si bien son cinéma de profane amoureux du 7ème art et dont le diptyque Kill Bill (par exemple) aura tant manqué.
Inglorious Basterds, film multi-genres s’il en est, signe donc le retour en grande forme de celui qui se permet décidément tout pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui aiment ça.
Les fans trouveront ce dernier petit bijou de délire absolument génial et irrésistible, les détracteurs n’en seront que plus réconfortés de tant d’impertinence voire d’irrévérence. S’appropriant pour mieux le rectifier le cours de l’Histoire et s’en donner à cœur joie sans jamais passer les frontières de l’irrespect, c’est le pari culotté d’un type qu’une vision totalement salutaire du cinéma pour s’amuser pousse au meilleur de lui-même.
Ludique, bavard, décapant, parfois frustrant et au final carrément dingue, Inglorious Basterds est tout simplement une farce (un tantinet saignante) indispensable à qui veut s’amuser un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et pour les autres … pas du tout. Tant pis pour eux !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
3
commentaires
![]()
lundi 24 août 2009
PINOCCHIO
 L’été étant, pour bon nombre d’entre nous, la période propice a une consommation exponentielle d’auteurs de qualité aussi variable que le nombre croissant de livres publiés en prévision de cette faste période, c’est très favorablement que j’ai laissé de côté (pour un temps seulement) La recherche afin de me consacrer à quelques « nouvelles expériences » littéraires … au risque tout relatif.
L’été étant, pour bon nombre d’entre nous, la période propice a une consommation exponentielle d’auteurs de qualité aussi variable que le nombre croissant de livres publiés en prévision de cette faste période, c’est très favorablement que j’ai laissé de côté (pour un temps seulement) La recherche afin de me consacrer à quelques « nouvelles expériences » littéraires … au risque tout relatif.
Bouleversé par Philippe Besson (l’extraordinaire En l’absence des hommes, le fameux Homme accidentel), captivé par Bernhard Schlink (Le liseur, sans compter sa très académique mais non moins touchante version cinématographique), déçu par Douglas Kennedy (Quitter le monde) incapable de se renouveler (on est bien loin de L’homme qui voulait vivre sa vie ou de La poursuite du bonheur), intrigué et éclairé par l’enquête de Marcel Gay et Roger Senzig (L’affaire Jeanne D’arc, à lire absolument), énervé par Moravia (Le mépris), c’est finalement par le biais de la bande-dessinée que j’aurai, cet été, pris un pied magistral … héhé !
Fauve d’or (Grand prix) du festival d’Angoulême 2009, Pinocchio (Ed. Les requins marteaux) est l’adaptation moderne, cynique et subversive du conte de Carlo Collodi par Winschluss (alias Vincent Parronaud le talentueux co-réalisateur du Persépolis de Marjane Satrapi). Dessins magnifiques (planches couleurs à la Disney, chapitres à peine crayonnés, ambiance noire, très noire) dialogues minimalistes, un discours corrosif jamais moralisateur d’une finesse, d’un humour (parfois « violent ») et d’une intelligence absolument remarquables ! Le genre de truc dont j’aurai regretté de ne pouvoir vous parler …
Publié par
rupert
Libellés :
Pages
2
commentaires
![]()
RUFUS ENCORE !!!!
 Alors que Muse dévoile petit à petit The Resistance (dans les bacs le 14 septembre), un album très attendu qui, à l’écoute des premiers extraits, s’annonce d’ores et déjà remarquable (écoutez le diptyque United States of Eurasia/Collateral Damage et vous m’en direz des nouvelles), Rufus Wainwright sort enfin son premier Live, Milwaukee At Last ! presque intégralement consacré à des chansons personnelles (le précédent était l’enregistrement de son concert hommage à Judy Garland).
Alors que Muse dévoile petit à petit The Resistance (dans les bacs le 14 septembre), un album très attendu qui, à l’écoute des premiers extraits, s’annonce d’ores et déjà remarquable (écoutez le diptyque United States of Eurasia/Collateral Damage et vous m’en direz des nouvelles), Rufus Wainwright sort enfin son premier Live, Milwaukee At Last ! presque intégralement consacré à des chansons personnelles (le précédent était l’enregistrement de son concert hommage à Judy Garland).
On attend ce petit bijou d’émotion de toutes sortes avec impatience d’autant qu’il est assorti, dans le même coffret, d’un DVD comportant l’intégralité de sa performance. Chouette !!!
Dans l’hexagone, pas grand-chose à l’horizon, si l’on excepte l’évènement prévu pour la fin de l’année : Une vie Saint Laurent, l’hommage chanté d’Alain Chamfort pour le grand couturier. On peut lire ici et là que l’album s’annonce plutôt très bien et c’est tant mieux parce que moi, Chamfort, j’adooore …
Publié par
rupert
Libellés :
Sonos
2
commentaires
![]()
BANDES-ANNONCES
 Que celles et ceux qui n’ont pas encore vu Là-haut (se lèvent) se ruent sur les nombreuses salles qui programment encore cet EXCELLENT dessin animé, tout de poésie et de drôlerie, et qui pose encore une fois LA question : comment se fait-il que l’ambition et l’originalité ne soit l’apanage que du cinéma d’animation ?
Que celles et ceux qui n’ont pas encore vu Là-haut (se lèvent) se ruent sur les nombreuses salles qui programment encore cet EXCELLENT dessin animé, tout de poésie et de drôlerie, et qui pose encore une fois LA question : comment se fait-il que l’ambition et l’originalité ne soit l’apanage que du cinéma d’animation ?
Grand mystère !
En attendant la sortie en novembre de l’adaptation (paraît-il moyenne, zut) du best-seller d’Audrey Niffenegger, The Time Traveller’s Wife (autrement dit Le temps n’est rien, que je vous ai déjà recommandé ici même) avec Eric Bana et Rachel McAdams, les curieuses et les curieux pourront déjà se faufiler dans les salles obscures pour une rentrée chargée : le Tarantino (Inglorious basterds, une farce géniale dont je vous reparlerai très vite), les frères Larrieux en grande forme (Les derniers jours du monde … une presse unanime, mais pas encore vu).
Ils auront peut-être la chance d’y voir le teaser d’Alice in Wonderland, l’éblouissante version de Tim Burton qui ne sortira qu’en mars 2010 (oui mais comme je vous le disais plus haut : le temps n’est rien). Et parce que vous savez que ça m’intéresse également, la team chargée d’écrire le scénario de Bond 23 vient d’être choisie par les producteurs : exit Paul Haggis, trop occupé par ses propres projets, et bienvenue à Peter Morgan (Le roi d’Ecosse) qui rejoint donc Neal Purvis et Robert Wade, fidèles depuis quelques épisodes déjà. Début du tournage fin 2010 pour une sortie prévue en novembre 2011 … vous n’avez pas fini d’en entendre parler !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
LE GRAND RETOUR
 Aux questions qui brûlent toutes les lèvres avides de connaissance et de nouvelles toutes fraîches, je répondrai sans honte, ni regret : NON ! L’appartement n’est pas encore terminé, mais … on avance, on avance, on avance (c'est une évidence ... comme chantait l’autre). N’empêche, vous me manquiez et j’avais envie de vous faire un petit signe ; autant que faire ce peut, ça se transforme en posts ! Aux chapitres de ceux qui vont suivre, de la lecture, du cinéma, de la musique … aucune grande surprise, mes goûts n’ayant pas varié avec la venue de l’été.
Aux questions qui brûlent toutes les lèvres avides de connaissance et de nouvelles toutes fraîches, je répondrai sans honte, ni regret : NON ! L’appartement n’est pas encore terminé, mais … on avance, on avance, on avance (c'est une évidence ... comme chantait l’autre). N’empêche, vous me manquiez et j’avais envie de vous faire un petit signe ; autant que faire ce peut, ça se transforme en posts ! Aux chapitres de ceux qui vont suivre, de la lecture, du cinéma, de la musique … aucune grande surprise, mes goûts n’ayant pas varié avec la venue de l’été.
Un petit mot avant tout ça, pour dire à tous les amoureux de cinéma que le director’s cut du chef-d’œuvre de Peter Bogdanovitch The Last Picture Show (La dernière séance) avec entre autres Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd (alors au tout début de leurs carrières respectives) est un moment presque inégalable de grand, d’immense cinéma. On trouve ça chez tous les bons marchands de DVD a un prix défiant toute concurrence et franchement vous auriez tort de vous en priver … Bonjour Vous !!!!
Publié par
rupert
Libellés :
Blabla
2
commentaires
![]()
vendredi 15 mai 2009
EH ... WHAT'S UP, DOC?
 Voilà ! Période délicate s’il en est - un déménagement toujours à mi-parcours (pas facile, facile), plus des travaux (ahlala) et côté boulot un changement de poste (je vous rassure, toujours dans cette grande maison à laquelle vous me savez très attaché) qui m’oblige à cumuler le travail de la fonction que j’occupe encore pour quelques semaines et celui de la fonction que j’occuperai ensuite (bah oui, c’est comme ça) – je n’ai pas ou peu de temps à consacrer à la mise à jour de mon actualité « culturelle » (mouais hihihihi) que je me suis toujours fait un devoir de rédiger pourtant régulièrement.
Voilà ! Période délicate s’il en est - un déménagement toujours à mi-parcours (pas facile, facile), plus des travaux (ahlala) et côté boulot un changement de poste (je vous rassure, toujours dans cette grande maison à laquelle vous me savez très attaché) qui m’oblige à cumuler le travail de la fonction que j’occupe encore pour quelques semaines et celui de la fonction que j’occuperai ensuite (bah oui, c’est comme ça) – je n’ai pas ou peu de temps à consacrer à la mise à jour de mon actualité « culturelle » (mouais hihihihi) que je me suis toujours fait un devoir de rédiger pourtant régulièrement.
Pas d’inquiétude, je reviendrai plus assidument à l’une de mes occupations favorites, qui me permet depuis 3 ans déjà d’exercer mes modestes capacités de « commentateur » en vous proposant des bafouilles aussi souvent que je le pourrai.
Pour l’heure, un petit point s’impose. La découverte d’un blog, Chroniques du plaisir, un indispensable parisien pour tous les épicuriens qui salivent à l’idée de visiter une nouvelle adresse ... miam (voir dans la bloglist ci-contre). Un excellent bouquin (pour le coup, un best seller) français (!) de Muriel Barbery, dont tout le monde ou presque a déjà parlé et à propos duquel tous les chroniqueurs littéraires de l’hexagone ont déjà écrit tout le bien qu’ils pensaient : L’élégance du hérisson. Sensible, intelligent et passionnant. Surtout, ne passez pas à côté !!!! Ensuite peu de cinéma et plutôt du léger pour profiter de cette carte qui me permet d’aller aussi souvent que je le veux dans les salles obscures des deux principaux réseaux de multiplexes de la capitale : Romaine par moins 30, une comédie farfelue, pleine de tendresse et de fraicheur, d’Agnès Obadia avec l’amusante Sandrine Kiberlain, ici larguée dans tous les sens du terme en pleine galère sentimentalo-québécoise, puis Star Trek, la nouvelle version plus ou moins décriée de J.J. Abrahams (bien que la majorité des critiques français semblent sous le charme de cet opus façon revival), que je trouve personnellement très distrayante et, en ce qui concerne l’intrigue et les effets spéciaux, franchement réussie (juste l’humble avis d’un non adepte du mythe).
Ensuite peu de cinéma et plutôt du léger pour profiter de cette carte qui me permet d’aller aussi souvent que je le veux dans les salles obscures des deux principaux réseaux de multiplexes de la capitale : Romaine par moins 30, une comédie farfelue, pleine de tendresse et de fraicheur, d’Agnès Obadia avec l’amusante Sandrine Kiberlain, ici larguée dans tous les sens du terme en pleine galère sentimentalo-québécoise, puis Star Trek, la nouvelle version plus ou moins décriée de J.J. Abrahams (bien que la majorité des critiques français semblent sous le charme de cet opus façon revival), que je trouve personnellement très distrayante et, en ce qui concerne l’intrigue et les effets spéciaux, franchement réussie (juste l’humble avis d’un non adepte du mythe).
Tout de même pas de très grands films en cette période où le Festival bat encore une fois son plein et où l’on attend avec impatience la sortie des derniers Almodovar (très bientôt !) et Lars Von Trier (auquel le Centre Pompidou consacre une formidable intégrale, à partir du 8 juin) dont je ne manquerai pas de vous parler ici, en principe ...
Publié par
rupert
Libellés :
Blabla,
Ecrans,
Pages
3
commentaires
![]()
mercredi 6 mai 2009
WOLVERINE
 Depuis quelques années, les gros studios américains soucieux de forte rentabilité (!), mais constamment en mal de projets « porteurs », se sont employés à confier les adaptations de comics de type DC ou Marvel (un filon presque inépuisable puisque selon son principe de base chaque « franchise capitalisable » est susceptible de permettre la mise en chantier immédiate d’une ou plusieurs suites) à des réalisateurs chevronnés ou, tout au moins, à ceux dont le savoir-faire serait un atout incontestable dans l’univers « complexe » des super-héros protéiformes cinématographiquement bankables.
Depuis quelques années, les gros studios américains soucieux de forte rentabilité (!), mais constamment en mal de projets « porteurs », se sont employés à confier les adaptations de comics de type DC ou Marvel (un filon presque inépuisable puisque selon son principe de base chaque « franchise capitalisable » est susceptible de permettre la mise en chantier immédiate d’une ou plusieurs suites) à des réalisateurs chevronnés ou, tout au moins, à ceux dont le savoir-faire serait un atout incontestable dans l’univers « complexe » des super-héros protéiformes cinématographiquement bankables.
Dans la première catégorie, certains, comme Brian Singer (X-Men 1 et 2, Superman returns), et surtout Christopher Nolan (Batman begins, The Dark Knight), font figure de références puisqu’ils ont réussi à transcender le genre en se l’appropriant, lui permettant ainsi d’atteindre le statut de film d’auteur majeur mais également d’œuvre universelle, donc internationalement et unilatéralement marchandable. C'est le cas du formidable Dark Knight (2008).
Dans la deuxième catégorie, où se disputent en tête les noms de Jon Favreau (Iron Man) et Zach Snyder (le discutable 300, le magnifique Watchmen), sont apparus des outsiders incontournables dans la dimension des illustrateurs inspirés qui ont su modeler ces personnages en collant moulant pour en faire des êtres doués « d’humanité » dans le sens le plus large du terme.
Alors forcément, quand ces mêmes studios, pourtant réputé pour leur frilosité, cèdent les rênes d’une adaptation « risquée » (le préquel d’un personnage central de la trilogie X-Men) à un réalisateur dont il serait culotté de dire qu’il a déjà fait ses preuves (Gavin Hood, celui de Mon nom est Tsotsi), on est légitimement susceptible de s’attendre au pire (cf : la troisième aventure des protégés du professeur X, une débâcle artistique financièrement mitigée). Pourtant il n’en est rien.
Evitée en dépit de quelques millions de dollars d’effets spéciaux parfois bâclés, et d’un scénario qui frôle l’ébauche (notamment en ce qui concerne l'obscure destinée de Deadpool/Weapon XI), la catastrophe annoncée est largement contrebalancée par quelques passages très distrayants durant lesquels des personnages, plus charismatiques que le héros dont il est ici question, se taillent la meilleure part du lion : au premier rang d’une galerie de « freaks » plus ou moins réussis, Dents de Sabre, ennemi juré de Wolverine (dont il devient le demi-frère dans cette version officialisée) salaud pervers, sadique et ambigu merveilleusement interprété par Liev Schriber à contre emploi, suivi de près par Gambit (l'inconnu Taylor Kitsch), héros énigmatique sous exploité qui mériterait à lui seul un film.
Et Wolverine dans tout ça ?
Résumées avant un générique de début à la fois inattendu et conventionnel, les origines tragiques du mutant (fidèles au premier numéro de Wolverine Origins) sont assez bien vues mais, toujours campé par le trop sophistiqué Hugh Jackman, l’évolution de sa personnalité au fil d’une histoire à l’ambiance bâtarde qui ne s’appuie ni tout à fait sur l’humour, ni tout à fait sur le drame, n’apparaît pas toujours très crédible (notamment dans sa période bûcheron).
Pour le reste, hormis une réalisation sans relief et une pléiade de figurants aux superpouvoirs sans grand intérêt, on peut sans être trop exigeant considérer que le contrat est rempli. Ni plus, ni moins ...
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
2
commentaires
![]()
lundi 4 mai 2009
STILL WALKING
 Comme chaque année à la même date, une famille se réunit pour commémorer la mort précoce du fils aîné.
Comme chaque année à la même date, une famille se réunit pour commémorer la mort précoce du fils aîné.
On prépare un festin, qui n’atténuera ni les sentiments, ni les ressentiments que silences et secrets laissent apparaître au fil des heures chaudes d’une belle journée d’été.
Usant à la fois de toute la subtilité et de l’humour discret que son sujet lui permet, le japonais Kore-Eda trace par petites touches délicates le portrait écaillé d’une famille désunie par le temps et ses drames. L’air de rien, au fil de scènes toutes de justesse et d’élégance, une caméra minimaliste porte un regard poétique et tendre sur les variations sensibles (ou moins) que chaque personnage laisse, à sa manière, peu à peu apparaître.
Où l’on se prend à confronter sa propre expérience, ses propres failles, sa propre intimité à celles éminemment sincères et profondes des représentations tangibles qu’un cinéma au plus près de la vérité, des choses, des sens et des autres prend le temps de développer.
Un film dense, touchant, qui parle de la disparition comme il parle des regrets, empreint de mélancolie mais qu’une réflexion savoureuse toute teintée d’ironie permet d’apprécier sans peine et sans tristesse. Un vrai régal !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
jeudi 30 avril 2009
PSB ... OH YEAH
 Et voilà ... les indétrônables Neil Tennant et Chris Lowe ont donc à nouveau réussi l’exploit de sortir l’un des albums les plus légers et à la fois les plus intéressants du moment, pas forcément surprenant au sens propre du terme, mais un de ces disques qui redonne à la pop(dance), dans tout ce qu’elle véhicule de plus basique et de plus « traditionnel », sa véritable identité, son incontestable raison d’être, sa place au sein d’un univers musical bouillonnant de genres, mais de plus en plus brouillon et difficilement identifiable en tant que tel. Au mieux, on atteint avec ce Yes estampillé Brian Higgins par le biais de Xenomania (co-production et co-écriture) le niveau des meilleurs opus du tandem. Au pire (mais pourquoi devrions-nous faire la fine bouche ?), on se délectera de quelques clins d’œil à une discothèque impeccablement datée 80’s et finalement toujours très appréciable (comme quoi).
Et voilà ... les indétrônables Neil Tennant et Chris Lowe ont donc à nouveau réussi l’exploit de sortir l’un des albums les plus légers et à la fois les plus intéressants du moment, pas forcément surprenant au sens propre du terme, mais un de ces disques qui redonne à la pop(dance), dans tout ce qu’elle véhicule de plus basique et de plus « traditionnel », sa véritable identité, son incontestable raison d’être, sa place au sein d’un univers musical bouillonnant de genres, mais de plus en plus brouillon et difficilement identifiable en tant que tel. Au mieux, on atteint avec ce Yes estampillé Brian Higgins par le biais de Xenomania (co-production et co-écriture) le niveau des meilleurs opus du tandem. Au pire (mais pourquoi devrions-nous faire la fine bouche ?), on se délectera de quelques clins d’œil à une discothèque impeccablement datée 80’s et finalement toujours très appréciable (comme quoi).
Pas très loin derrière un Behaviour qu’on peut aisément considérer comme le pilier d’une série de réussites sensationnelles (peut-être l’adjectif qui définit le mieux les deux « anglaises ») et bien au-dessus de quelques tentatives pour le moins indigestes (dont le bien mal nommé Fundamental), Yes marque surtout le retour ou l’arrivée d’une batterie d’invités prestigieux et légitimement appréciés du duo référent, comme (entre autres) l’ex-Smiths Johnny Marr, presque un habitué, mais également le violoniste canadien Owen Pallett (plus connu sous le nom de Final Fantasy et arrangeur, notamment, pour Arcade Fire) ou encore le producteur et musicien français Fred Falke ... tout au long d'un programme particulièrement réjouissant.
Yes démarre directement sur un hymne pop idéal, Love Etc, premier single en guise d’amuse bouche acidulé pas si innocent que ça, avant d’enchainer directement par un All Over The World majestueux (et sa reprise culottée du Casse-Noisette de Tchaïkovsky) amorçant la montée en puissance obligatoire qu’une apothéose disco réjouissante, Did You See Me Coming (!!!), deuxième extrait certes conventionnel mais à l’énorme capacité dansante, vient confirmer sans effort.
La suite est à l’avenant : More Than a Dream et sa rythmique funky, l’imparable Pandemonium et son tempo punchy, le pertinent Building A Wall ... mais c’est dans sa dernière partie que cet album salutaire recèle les deux magnifiques perles qui lui permettront d’approcher les premières places d’une discographie flirtant ainsi avec le nec plus ultra. Si l’envoutant et très chaloupé King of Rome, morceau apaisé, agit comme un charme imparable, on se délectera d’un final ambitieux avec ce Legacy grandiose, condensé de démesure tout en cuivres puissants et en percussions luxuriantes.
Visiblement indémodables, pratiquement indispensables, à coup sûr cette fois-ci les Pet Shop Boys ont tout bon. Ooooh ...Yes !
Publié par
rupert
Libellés :
Sonos
1 commentaires
![]()
mercredi 29 avril 2009
DANS LA BRUME ELECTRIQUE
 Un authentique film d’ambiance, noir, imprégné jusqu’à la moelle de blues cajun, et qui porte à la quintessence une œuvre forte, baignée de moiteur.
Un authentique film d’ambiance, noir, imprégné jusqu’à la moelle de blues cajun, et qui porte à la quintessence une œuvre forte, baignée de moiteur.
C’est qu’en véritable américanophile assumé (Autour de minuit, son hommage au jazz, Coup de torchon, son adaptation d’un polar de Jim Thompson ...) Bertrand Tavernier n’a pris aucun détour pour transposer en images l’univers ô combien mystique du grand roman de James Lee Burke, In the Electric Mist with Confederate Dead (1993), dont l’action se situait déjà en Louisiane. Si l’intrigue, solide mais somme toute assez convenue (une enquête un peu sordide dans le milieu du cinéma et de la pègre locale), reste fidèle à l’esprit du livre, culte et tout entier dédié à la personnalité si caractéristique de Dave Robicheaux (personnage de détective essentiel et récurrent dans l’œuvre de l’écrivain), elle n’en reste pas moins secondaire comparée à la force visuelle et narrative de l’objet, avec en prime une voix off qui vient contrebalancer l’atmosphère pesante et insaisissable des bayous.
Flirtant sans ambivalence avec le surnaturel, le réalisateur cinéphile se fend d’une mise en scène extrêmement soignée, au classicisme admirable (on sent les références) et qui n’hésite pas à imposer une partition plus lente que celles désormais dévolues aux œuvres du genre. On pense à Eastwood, bien entendu. Enfin, ... celui des grands films !
D’ailleurs, Tommy Lee Jones (qui a également contribué à l’écriture de certaines scènes) porte la « panoplie » du flic à la perfection, et stimule la comparaison avec son compatriote tout au long de ce parcours intime qu’un passé révélé viendra hanter pour mieux éclairer le cheminement présent.
Aussi sombre, mystérieux et fascinant qu’un vrai rêve ...
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
3
commentaires
![]()
mercredi 22 avril 2009
RIO NE REPOND PLUS !
 Le retour de l’agent « secret » français nouvelle formule, alias Hubert Bonnisseur de la Bath alias OSS117, pour une mission exotique aussi rocambolesque qu’irrésistiblement drôle.
Le retour de l’agent « secret » français nouvelle formule, alias Hubert Bonnisseur de la Bath alias OSS117, pour une mission exotique aussi rocambolesque qu’irrésistiblement drôle.
Complétant et performant la panoplie parodique de l’espion dont la crétinerie n’a d’égal que l’enchainement malheureux de jeux de mots tous plus nuls les uns que les autres, le réalisateur Michel Hazanavicius et son acteur fétiche, l’extraordinaire Jean Dujardin, se jouent des clichés en les enfilant méthodiquement, consciencieusement, comme autant de perles d’un cinéma populaire dont Bébel fût longtemps le seul et unique représentant.
En digne héritier tout à fait à l’aise dans la peau d’un « magnifique as des as » plus vrai et surtout plus décapant que l’original, car plus enclin encore à se tourner en ridicule, Dujardin se fend d’une interprétation carabinée et exécute sa désopilante performance, à un niveau tel qu’il est absolument impossible d’imaginer qui que ce soit d’autre à sa place. Déblatérant une incroyable somme de répliques absolument débiles voire irrévérencieuses (donc déjà cultes) au rythme des cascades et des coups de pétards qui saccadent à intervalle régulier ces aventures brésiliennes terriblement jouissives, il entraine l’ensemble de la distribution avec lui en gagnant au passage la sympathie d’une salle en tous points unanime.
Artistiquement parlant, le film d’une qualité visuelle rare (en nos contrées) transporte carrément les spectateurs à l’aune des années 60 (collages pop et effets toc), ce qui, en soit, est déjà une expérience assez enthousiasmante pour qu’on la salue avec tous les honneurs qu’elle mérite. Bravo !!!!
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
6
commentaires
![]()
mardi 21 avril 2009
WELCOME
 A la bourre, oui, je suis à la bourre, mais que voulez-vous ... on ne peut pas tout faire !
A la bourre, oui, je suis à la bourre, mais que voulez-vous ... on ne peut pas tout faire !
Comme je consacre actuellement plus de temps à passer d’un appartement à l’autre - en attendant d’intégrer (un jour peut-être ?) ma nouvelle « niche » (non, non, je ne suis pas désespéré) - plutôt qu’à vous faire part de mes habituels commentaires sur tout et sur rien, je prends du retard et voilà ... je me retrouve aujourd’hui à poster un avis sur un film que j’ai vu (et vous aussi certainement) il y a plusieurs semaines déjà.
Je pourrai passer outre et, ni vu ni connu, faire comme si de rien était ... Mais voilà, Welcome, le dernier Philippe Lioret est tout simplement une très belle histoire, un drame social terrible, poignant, porté par des acteurs et des actrices habités et magnifiques. Cette histoire, c’est celle d’un jeune kurde, Bilal (Firat Ayverdi, une découverte), qui, incapable de passer la manche en voyageant clandestinement dans les camions de marchandises, se voit contraint d’apprendre à nager pour tenter une traversée dangereuse, périlleuse et pratiquement impossible. C’est surtout l’histoire de sa rencontre avec un maître nageur au bout du rouleau, quadragénaire largué, qui va se mettre en danger pour différentes raisons, et pas toujours les meilleures.
Ce personnage d’égoïste esseulé, rustre et introverti, emprunte les traits et la carrure de Vincent Lindon. Egal à lui-même et comme souvent impeccable, il donne une dimension supplémentaire à un rôle plus casse-gueule qu’il y parait.
Grâce à cette distribution (sans faute), et à des prises de position frontales, sans concession, Lioret dresse le portrait touchant d’hommes sincères qui vont apprendre à se connaître.
En puisant dans l’actualité et en s’inspirant du calvaire des milliers de migrants clandestins qui cherchent à rejoindre l’Angleterre coûte que coûte, il assoit son scénario subtil, sensible et plutôt pudique (écrit en collaboration avec Emmanuel Courcol et Olivier Adam) sur un propos « politique » brillant et jamais démonstratif. A voir absolument !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
vendredi 10 avril 2009
LA PREMIERE ETOILE
 Voici l’exemple type du film français « de saison » sans aucune prétention qui, pour des raisons aussi diverses que variées, emballe presque unanimement une critique hétéroclite souvent plus inspirée ... quoi que.
Voici l’exemple type du film français « de saison » sans aucune prétention qui, pour des raisons aussi diverses que variées, emballe presque unanimement une critique hétéroclite souvent plus inspirée ... quoi que.
L'exemple d’une petite (toute petite) comédie sociale (euh) forcément sympathique puisqu’on y raconte l’histoire apparemment incroyable ( ?!) mais terriblement caricaturale d’une famille noire (enfin, pas tout à fait) sans le sou, qui part pour la toute première fois au ski.
Bon, à priori, ce n'est pas ma tasse de thé ... sauf que cette Première étoile est tellement bien vendue par un plan média béton (si, si) par le biais d’une campagne radio/presse exagérée et exagérément indulgente qu’il est finalement difficile d’y résister. Non pas que le film de Lucien Jean-Baptiste, également scénariste et acteur principal, soit mauvais ; on y décèle même ça et là un certain vécu qui ne serait pas pour nous déplaire.
Sincère, généreux, pas avare en bons sentiments (ça peut aussi être une qualité) et plutôt simple (non, pas simpliste, mais pas loin) il véhicule des valeurs morales « honorables » et une certaine tendresse qu’on qualifiera d’agréable. Avouons toutefois qu’il ne déparerait pas dans la grille télé d’une programmation aseptisée d’un milieu de semaine.
Mignon, gentillet, il dresse le portrait de quelques personnages pas tous très savoureux (Firmine Richard en grand-mère « Pani » la plupart du temps incompréhensible, Bernadette Lafont en revêche, raciste et repentie, Michel Jonasz en substitut de papy frustré ...), mais heureusement attachants, dont les tribulations gagesques exagérément maladroites et souvent téléphonées finissent par lasser. Carrément dispensable ...
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
2
commentaires
![]()
mardi 7 avril 2009
FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
 Les pittoresques aventures du Petit Billy, que son père emmène passer les vacances d'été en Alabama, dans la ferme de l’oncle Sagamore.
Les pittoresques aventures du Petit Billy, que son père emmène passer les vacances d'été en Alabama, dans la ferme de l’oncle Sagamore.
Quand les fameux Frères Noonan (l’un parieur hippique professionnel et fauché, l’autre distillateur d’alcool de contrebande) se retrouvent, qu’ils décident d’héberger sur un bout de terrain le curieux Docteur Severance et sa nièce, la magnifique Miss Harrington, qui passe le plus clair de son temps dans le plus simple appareil ou presque, alors que la chasse au lapins bat son plein … tout le Conté (et même ceux environnants) s’enflamme.
Raconté de manière totalement originale à travers le regard très distancié d’un enfant de 7 ans, dont l’éducation s’est faite uniquement sur les champs de courses, le cultissime The Diamond Bikini (titre original plus opportun) est un petit bijou d’humour décallé et très très fin de Charles Williams. Désastreusement adapté en 1970 par le calamiteux Gérard Pirès (avec Lino Ventura, Mireille Darc et Jean Yanne dans les rôles titres ... du grand n'importe quoi !!!!!), ce roman « noir » vaut bien mieux que la catastrophique réputation du film qui en a été tiré, et mérite incontestablement qu’on y passe quelques heures d’un bonheur intact, sans réserve. Une vraie détente.
Publié par
rupert
Libellés :
Pages
0
commentaires
![]()
lundi 6 avril 2009
DUPLICITY
 L’histoire un peu « complexifiée » de deux ex-agents de la CIA et du MI6, qui se tirent la bourre dans le milieu de l’espionnage industriel.
L’histoire un peu « complexifiée » de deux ex-agents de la CIA et du MI6, qui se tirent la bourre dans le milieu de l’espionnage industriel.
Le début est assez alambiqué pour qu’on se demande si passer plus de deux heures en leur compagnie est une bonne idée, mais rapidement le charme des acteurs opère et la construction du film (un enchainement de flashbacks parfois répétitifs) prend tout son sens.
S’il faut reconnaître à Tony Gilroy, dont c’est ici la seconde réalisation après Michael Clayton, une certaine aisance dans la direction d’acteur et un raffinement qui sied parfaitement à l’atmosphère du film, on ne peut s’empêcher de regretter un manque d’originalité qui donne à l’ensemble, en particulier dans sa deuxième partie, l’allure d’une bonne série B.
Cumulant plus ou moins adroitement les clichés afférents aux codes du genre, Duplicity laisse ce petit goût amer qu'ont les grands rendez-vous un peu décevants, sans être pour autant désagréables.
Alors bien sûr, on se raccroche au charisme et à la beauté indéniable des deux stars (quarantenaires et, croyez-moi, ça fait un bien fou !!!) : l’incomparable sourire de Julia Roberts vaut à lui seul le prix d’une place de cinéma, quant à Clive Owen, est-ce bien la peine de préciser qu’il représente à lui seul l’archétype de la virilité et de la séduction masculine dans le cinéma hollywoodien actuel (une vraie bombe).
Tant qu’y a du plaisir …
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
4
commentaires
![]()
mardi 31 mars 2009
LA JOURNEE DE LA JUPE
 S’il est un film à ne rater sous aucun - oui vous avez bien lu ! - aucun prétexte, c’est bien celui-ci.
S’il est un film à ne rater sous aucun - oui vous avez bien lu ! - aucun prétexte, c’est bien celui-ci.
A la base, projet impossible à monter pour le cinéma, La journée de la jupe a bénéficié du soutien financier d’Arte qui, en le diffusant quelques jours avant sa sortie officielle en salle, a réussi l’exploit de réaliser 9,6% de part de marché le 20 mars dernier (soit l’une des meilleures audiences de la chaîne depuis le début de son existence).
Pour ce résultat, Jean-paul Lilienfeld, le réalisateur, n’a pas hésité à mettre le meilleur des atouts de son côté. En proposant ce rôle de prof au bout du rouleau, qui se retrouve presque malgré elle à braquer ses propres élèves, à l’une des actrices les plus rares, les plus sensibles et les plus impliquées que le cinéma français ait jamais eu, il a misé fort et juste.
Digne, bouleversée et réellement bouleversante, Isabelle Adjani y est une nouvelle fois incomparable. Difficile d’imaginer une autre femme dans ce registre engagé mais subtil qui, on le sait déjà, lui va comme un gant. Il faut la voir, le flingue (énorme) à la main, dans le silence impressionnant de cette salle capitonnée, réciter un cours sur Molière « ... Jean-Baptiste Poquelin !!!!! », et engager un dialogue primordial, capital, sur la laïcité. Car c’est bien là le principal sujet de cette fable sociale. Celui qui la rend si pertinente et essentielle. En appuyant son discours sur les préceptes et les fondements même de l’école publique, Lilienfeld (pas exempt de lourdeurs, de clichés mais qui s’en accommode au mieux) développe un magnifique plaidoyer sur l’égalité, la mixité, le respect sous toutes ses formes, au travers duquel le langage, le verbe, se révèle être l’arme la plus efficace.
A savoir : la revendication du titre, réclamée au Ministre de l'Éducation Nationale par Sonia Bergerac (Isabelle Adjani), est tout à fait d’actualité puisque l'association Libertés Couleurs (comme d'autres) est déjà, depuis plusieurs années, l’initiatrice d'un Printemps de la jupe et du respect (voir le site).
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
4
commentaires
![]()
vendredi 27 mars 2009
WARHOLA REPLAY
 Est-ce rendre hommage à l’une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années que de lui consacrer une exposition/portrait des « grands de ce monde » ? Pas certain !
Est-ce rendre hommage à l’une des personnalités les plus marquantes de ces 50 dernières années que de lui consacrer une exposition/portrait des « grands de ce monde » ? Pas certain !
Surtout quand au bout de quelques salles la nausée s’installe et la lassitude (250 toiles quand même !) l’emporte sur l’émerveillement que provoquent, dès l’entrée, ces fameuses séries de Marylin, icône transcendée et transgressée qui perd avec Warhol toute son humanité pour n’être plus qu’une image comparable à celle de milliers d’autres, aussi colorée et désincarnée qu’une boîte de soupe Campbell's. Dans ce Grand monde d'Andy Warhol (quel titre ridicule !), indigeste et répétitif, tout tombe à plat. En oubliant volontairement une grande partie du travail de « l’artiste » (ce que Warhol ne se considérait pas), Alain Cueff, le commissaire, est totalement inapte à développer un discours capable de susciter le moindre intérêt.
On déambule de plus en plus rapidement au fil d’un accrochage très discutable (même si certaines œuvres un peu inattendues comme cette Big Electric Chair, 1967, valent la visite) en constatant, avec dommage, ce qu’aurait pu donner une véritable rétrospective, ambitieuse, décadente, où les réflexions de « la Warhola au gros nez rouge », ici de simple extraits d’interviews misérablement collés sur les cimaises d’une scénographie tellement minimaliste qu’elle en perd tout intérêt, auraient pris tout leur sens, celui d’une certaine philosophie de la vie vu à travers le prisme de la Factory.
Les informations succinctes – 25 000 dollars pour le premier panneau, 15 000 pour les suivants …, ou la date à laquelle il commence à utiliser la poudre de diamant - ne relèvent jamais la laideur de cartels ÉNORMES et inutiles. Rien à dire. Tout est là, devant nos yeux, l’intelligence d’un Warhol, obsédé par le fric, étant d’avoir créé un process lui permettant « d’industrialiser » l’art et notamment l’art du portrait pour en faire quelque chose de beaucoup plus intéressant : une critique acerbe et pertinente de la société. Visiblement, au Grand Palais, on l’a complètement oublié ou volontairement occulté. Une vraie grande déception !!!



Publié par
rupert
Libellés :
Expos
5
commentaires
![]()
jeudi 26 mars 2009
LaCHAPELLE : RECOLLECTIONS
 Première exposition emblématique issue du fameux « Conseil culturel » de la monnaie de Paris, mis en place au printemps 2008 par son Président-Directeur général Christophe Beaux, la « rétrospective » David LaChapelle est un événement pour plusieurs raisons.
Première exposition emblématique issue du fameux « Conseil culturel » de la monnaie de Paris, mis en place au printemps 2008 par son Président-Directeur général Christophe Beaux, la « rétrospective » David LaChapelle est un événement pour plusieurs raisons.
D’abord le choix, extrêmement « people », de présenter dans l’une des plus anciennes institutions françaises le travail d’un photographe branché moins reconnu dans le milieu artistique que dans celui, d’ailleurs pas forcément plus ouvert, de la fashion culture américaine. Ensuite parce que LaChapelle n’a encore jamais bénéficié d’une telle exposition dans nos contrées hexagonales et que, même si cette présentation ne constitue que l’une des nombreuses haltes d’un parcours « promotionnel » itinérant depuis bon nombre de mois déjà, les « fresques » photographiques constituant l’essentiel de son travail ces dernière années gagnent à être vues dans leur format d’origine.
Ce n’est donc qu’au prix excessif d’un billet d’entrée à 10€ (quand même) qu’il sera possible, enfin, d’appréhender dans toutes leurs dimensions « cartonesques » quelques unes des fameuses, volumineuses et clinquantes compositions (Holy War, Decadence : The Insufficiency of All Things Attainable …) dont le malin photographe s’est fait le spécialiste sans grand frais (et ce dans tous les sens du terme).
On préfèrera donc s’attarder sur l’une des pièces maitresses de cette rétrospective écrémée (seul un catalogue fort dispendieux permet de se faire une réelle idée de la somme et de la qualité du travail de cet acharné), infime partie d’un ensemble en fait composé de nombreux clichés extrêmement complexes : Deluge. 


Pas toujours très subtile mais picturalement bluffante, comme la plupart des œuvres exposées, on pourra également s’extasier devant une succession d’hommages « christiques » où stars et modèles se prêtent aux jeux de rôles imposés par des thèmes souvent pertinents.


Au centre de ce parcours dédié aux grands formats, un petit bijoux d’ironie qui pourrait à lui seul faire l’objet d’un accrochage spécifique : Recollections in America. Une série réalisée à partir de clichés datant des années 70, représentant des regroupements familiaux ou amicaux (fêtes, réunions) dont le contexte est transformé par l’insertion parfaitement invisible d’objets et de personnages.
C’est presque là que tout le talent de l’artiste se révèle, dans cette force d’analyse humoristique et forcément grinçante de la classe moyenne américaine à travers ses propres valeurs. Un must !


Publié par
rupert
Libellés :
Expos
2
commentaires
![]()
mardi 17 mars 2009
LOIN DE LA TERRE BRÛLÉE
 Scénariste inspiré de la plupart des films d’ Inarritu (dont les excellents Amours chiennes, 21 grammes,et le plus convenu Babel, en forme de redite), Guillermo Arriaga signe enfin, avec The Burning Plain, sa première réalisation.
Scénariste inspiré de la plupart des films d’ Inarritu (dont les excellents Amours chiennes, 21 grammes,et le plus convenu Babel, en forme de redite), Guillermo Arriaga signe enfin, avec The Burning Plain, sa première réalisation.
Gâté par un casting féminin de rêve qui lui a permis, à n’en pas douter, de boucler son budget, il se contente de reprendre les (grosses) ficelles d’un principe qui a, un temps, fait sa renommée (le puzzle narratif), mais dont la mécanique ultra prévisible ne surprend plus personne.
Avec une bonne longueur d’avance sur tous les personnages du film, le spectateur frustré s’accroche à une distribution sans faille mais qui méritait mieux. La jeune Jennifer Lawrence, une découverte, est sans aucun doute promise à une belle carrière et la belle Charlize Théron joue à merveille le rôle pas assez trouble d’une femme rattrapée par son passé.
Mais c’est la très charnelle Kim Basinger qui, comparable au bon vin qui se bonifie avec le temps, l’emporte haut la main dans ce jeu de faux chassés-croisés temporels et géographiques. Une prestation sensible et sensuelle, toute en retenue, qui mérite à elle seule qu’on aille jusqu’au bout de cette escapade mexicaine à la photographie soignée mais à l’intrigue éventée (déjà le titre français). Au final, la déception n’en est que plus grande …
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
1 commentaires
![]()
samedi 14 mars 2009
HARVEY MILK
 Les années 70 à San Francisco : en changeant les mentalités et en favorisant la coopération entre les minorités sociales et ethniques, Harvey Milk devient le premier homosexuel militant engagé à accéder à des fonctions officielles en Californie.
Les années 70 à San Francisco : en changeant les mentalités et en favorisant la coopération entre les minorités sociales et ethniques, Harvey Milk devient le premier homosexuel militant engagé à accéder à des fonctions officielles en Californie.
S’appuyant fidèlement sur le scénario plutôt radical de Dustin Lance Black, Gus Van Sant, presque à l’image du personnage passionné mais investi dont il dresse en partie le portrait, ne se laisse jamais déborder par les drames intimes qui surgissent au fil d’un parcours que l’engagement prédomine.
C’est la principale leçon de cette formidable biographie, à travers laquelle le cinéaste en profite pour raconter, à la manière d'un documentaire, les déboires d’une Amérique alors partagée par son désir d’émancipation et un puritanisme implacable, dont la grande réussite du film est de nous rappeler qu’il est encore d’une brûlante actualité. Et dans ce choix décisif à couvrir uniquement la période allant de l’entrée en politique d’Harvey Milk jusqu’à son assassinat (8 ans en tout et pour tout), Van Sant et surtout Black (intransigeant) donnent véritablement toute la mesure de l’implication de l’homme dans son combat, essentiel, vital, pas exempt d’erreurs ni de faux pas, et donc éminemment humain.
C’est ce même choix agrémenté de passionnantes images d’archives qui justifie les parti pris narratifs et esthétiques (une belle référence à Hockney) d’un récit qui ne s’appesanti jamais sur les idéaux sacrifiés d’une vie privée à peine esquissée, pour mieux se concentrer sur sa véritable raison d’être : la lutte incessante pour la tolérance, le respect.
Magistral dans un registre délicat, Sean Penn est sidérant de vérité. Il se fond intégralement dans la peau de Milk et emporte avec lui une distribution parfaite (en première ligne Josh Brolin, James Franco et Emile Hirsch) qui s’oublie totalement dans une interprétation en tout point investie. Une œuvre militante, importante, et accomplie. Un film essentiel !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
8
commentaires
![]()
mercredi 11 mars 2009
WATCHMEN
 De BD, que dis-je, de roman graphique réputé inadaptable, Watchmen – Les gardiens s’est bien vite transformé au cours de ces dernières années en buzz internet incroyable auquel, à des degrés de fiabilité divers, de nombreux réalisateurs, et pas des moindres, ont été plus ou moins associés.
De BD, que dis-je, de roman graphique réputé inadaptable, Watchmen – Les gardiens s’est bien vite transformé au cours de ces dernières années en buzz internet incroyable auquel, à des degrés de fiabilité divers, de nombreux réalisateurs, et pas des moindres, ont été plus ou moins associés.
En tête d’un palmarès que je ne listerai point, le talentueux - mais gigantesque « foireur » - Terry Gilliam a failli s’approprier le travail de l’excessif Alan Moore, auteur de bandes dessinées depuis longtemps convaincu de l’incapacité des studios à reproduire pertinemment une œuvre graphique dans son fond comme dans sa forme. Jusqu’à présent, force était de constater qu’il avait raison. L’un des comics les plus originaux de Moore, La ligue des gentlemans extraordinaires, fut un véritable fiasco artistique (retiré des studios après ce premier film, le réalisateur ne s’en est d’ailleurs toujours pas remis).
Quant au très stylisé V pour Vendetta, pas aussi mal fichu qu’on pouvait s’y attendre, il est loin d’atteindre les prétentions intellectuelles de l’ouvrage très abouti dont il est issu. Certes, Watchmen, le film, n’est pas un chef-d’œuvre.
Pourtant, on frôle l’objet culte. Qu’un réalisateur moyen, tendance « tâcheron » aux ambitions artistiques encore inhibés en ait été le metteur en scène n’y est pas pour rien ... au contraire.
En mettant de côté l’appétit créatif certain dont un cinéaste imaginatif, chevronné et accompli (tout le portrait de Gilliam) n’aurait pas manqué pour s’approprier totalement le projet, et en adaptant avec fidélité, voire dévotion (quasi religieuse, mais Zack Snyder est un vrai fan et ça se voit) les 396 pages nécessaires à l’élaboration d’une intrigue extrêmement complexe impliquant plusieurs périodes de l’Histoire « récente » des Etats-Unis, dans une version complètement révisée (les américains ont gagné la guerre du Vietnam et Nixon est élu Président pour la troisième fois consécutive ...), le réalisateur de 300 (pas forcément la preuve d’un grand talent) a presque humblement réussi à extirper ce qui faisait l’ossature, le sens, l’intérêt du bouquin de Moore et Gibbons (le dessinateur).
A découper son film comme s’il s’agissait des vignettes d’un comics, à passer (parfois en s’attardant même un peu trop) d’un personnage à l’autre, d’une situation à l’autre, tout en jouant des rythmes (plutôt contemplatif lorsqu’on côtoie Dr Manhattan, plutôt expéditif lorsqu’on suit les pérégrinations de Rorschach …), des couleurs incroyables (oui, très kitsch, mais elles sont autant d’indices qui complètent l’intrigue) et à traiter les effets spéciaux non pas comme des exploits de post production (style Lucas) mais comme les composantes naturelles d’un monde parallèle où vivent des êtres exceptionnels, Snyder reste complètement en phase avec le monument graphique qui prend enfin corps et vie sous nos yeux éblouis : génialement campés par des acteurs discrets aux physiques parfaitement identiques aux personnages de Gibbons, les héros (parfois super et parfois moins) ont une âme, un destin.
Un chouia simplifié (exit le personnage du Capitaine Métropolis, exit les intermèdes narratifs … qui devraient, paraît-il, composer les bonus du DVD à venir) et à peine modifié (pas besoin, l’action a beau se passer dans les années 80, on nage bizarrement en plein dans l’actualité politique de cette décennie) le scénario ne déçoit pas, n’atténue pas et se joue complètement des interdits et frustrations que bon nombre de studios auraient été susceptibles d’imposer à n’importe quel blockbuster (cf. : toutes les adaptations depuis le Batman de Burton, excepté The Dark Knight de Nolan). Mais justement, ce Watchmen si fidèle à son modèle imprimé fait-il vraiment figure de blockbuster ? Certainement pas ! Et c'est indéniablement sa plus grande qualité.
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
dimanche 8 mars 2009
LE PARC
 Créé en 1994 pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, Le Parc est une est une œuvre qui s’inscrit dans la veine des chorégraphies dites « néo-classiques » d’Angelin Preljocaj.
Créé en 1994 pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, Le Parc est une est une œuvre qui s’inscrit dans la veine des chorégraphies dites « néo-classiques » d’Angelin Preljocaj.
S’appuyant à la fois sur un classicisme structuré atypique et sur une partie du langage moderne et original qui caractérise certaines de ses créations, l’artiste d’origine albanaise y traite progressivement, avec humour, tendresse et mélancolie, d’espiègle badinerie, de jeux de séduction, du cheminement des passions et d’amour, bien sûr, dans un jardin français.
Ici aucun recour aux images de synthèse, aux nouvelles technologies dont Preljocaj, on le sait, est devenu depuis la fin des années 90 un brillant adepte. Sur une partition musicale principalement empruntée à Mozart (extraits de pièces pour cordes et de concertos - sublimes – pour pianos) formidablement complétée par des créations sonores de Goran Vejvoda, le décor massif (arbres géométriques gigantesques sur ciel changeant) mais étonnamment mouvant de Thierry Leproust, participe de ces chorégraphies à la fois inventives, ludiques, répétitives puis sensuelles et éminemment touchantes dont, actuellement à Garnier, les étoiles Delphine Moussin et Yann Bridard sont (entre autres) les deux protagonistes principaux.
Un hommage moderne, intelligent, vivifiant au Siècle des Lumières (coup de chapeau à celles de Jacques Châtelet), à la beauté rythmique des corps superbement costumés (beau travail d’Hervé Pierre) dans l’expression et l’exaltation des sentiments amoureux. Un spectacle de tous les sens, exceptionnel et très émouvant.
Ci-dessous : Abandon, interprété en 1999 par Isabelle Guérin et Laurent Hilaire (Adajio du Concerto pour piano n°23 – K. 488)
Publié par
rupert
Libellés :
Scènes
0
commentaires
![]()
mercredi 4 mars 2009
THE WRESTLER
 Darren Aronofsky est de ces réalisateurs dont j’ai pour (inconditionnelle) habitude d’apprécier la palette narrative et l’esthétisme mis en œuvre pour « emporter » les spectateurs dans des univers toujours très personnels ... qualités en effet incontestables de ses trois premiers films : Pi, Requiem for a Dream (l’adaptation choc du roman d’Hubert Selby) et même, oui même, l’étrange O.V.N.I. cinématographique qu’est The Fountain.
Darren Aronofsky est de ces réalisateurs dont j’ai pour (inconditionnelle) habitude d’apprécier la palette narrative et l’esthétisme mis en œuvre pour « emporter » les spectateurs dans des univers toujours très personnels ... qualités en effet incontestables de ses trois premiers films : Pi, Requiem for a Dream (l’adaptation choc du roman d’Hubert Selby) et même, oui même, l’étrange O.V.N.I. cinématographique qu’est The Fountain.
Dans le quatrième, il a fait table rase de toutes considérations artistiques pour coller au mieux de la réalité des choses, même des plus trash. Caméra à l’épaule, image documentaire (enfin presque !), The Wrestler plonge dans le quotidien triste d’un homme à la ramasse, jusqu'à sa déchéance. S’accrochant, comme à une bouée de sauvetage, à une jolie stripteaseuse en fin de carrière (la touchante Marisa Tomei) et à cette fille (Evan Rachel Wood, un talent qui monte) dont il n’a jamais pris le temps de s’occuper, Randy, le catcheur du titre, se débat dans les méandres qu’une vie de solitude accentuée par un physique au bout du rouleau ont fini par complètement absorber, et qui, résolu, tente absolument de « renaitre ».
Alors forcément, rien de tel qu’une star déchue pour interpréter avec force symbolisme et totale identification, la résurrection de ce Bélier (The Ram en V.O.) en quête de lui-même. Dans le rôle, difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Rourke. Il est ce personnage totalement émouvant avec lequel, évidemment le parallèle s’impose. En s’appuyant sur les failles, les blessures et le parcours de son acteur principal, Aronofsky a fait LE choix, celui qui a permis sans aucun doute à The Wrestler d’être primé notamment à Venise. Sauf qu’à trop d’identification on en oublie presque que ce Randy existe pour lui-même et c’est finalement à LA star au parcours chaotique que se retrouve véritablement confronté le spectateur.
C’est à la fois le plus gros défaut mais aussi, il faut le reconnaître, la plus grande qualité de ce film très émouvant qui peine pourtant, parfois, à se démarquer de ses incontournables références (!). Pour le coup, c’est juste un peu dommage ...
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
lundi 2 mars 2009
LA TRAHISON
 Thomas et Paul sont les meilleurs amis du monde.
Thomas et Paul sont les meilleurs amis du monde.
De vrais frères. Nés le même jour (celui très symbolique d’août 45 où les Etats-Unis ont lâché la première bombe atomique sur Hiroshima), mais pas dans la même ville, ils grandissent ensemble à Natchez, sur les rives du Mississipi. Là, inséparables dans la joie, dans les plaisirs d’un quotidien presque ordinaire, comme dans la douleur, ils grandissent dévastés par l’absence d’un père, pour l’un, d’un frère, pour l’autre.
On les expose au racisme le plus radical (celui du sud), ils fréquentent l’église, puis découvrent la politique, la télévision et … l’amour, bien sûr. Bien sûr ! Et c’est à cette découverte, très tardive, dans ce roman simple à l’écriture extrêmement fluide (tellement qu’elle en est parfois déconcertante), que la trahison du titre révélateur sera inévitablement liée.
Pas besoin d’être finaud pour comprendre bien avant la première moitié d’un livre au style si délicat, si sensible qu’il en devient rapidement appétissant, aux chapitres si riches et à la fois si courts qu’on en devient vite gourmand, à quoi tiendra la fin immanquablement tragique de cette chronique intimiste et touchante.
Celle, singulière, de ces deux personnages, mais également celle, en filigrane et autrement plus complexe, d’une Amérique faussement idéalisée par la représentation de ce tableau d’Hopper, High Road, en couverture.
Une Amérique d’Histoire (Eisenhower, l’assassinat de Kennedy, la disparition de Marylin, celle de Luther King, les batailles idéologiques, l’embrasement des universités…) que le fardeau de deux guerres (Corée, Vietnam) plus celui du McCarthysme viendra entacher de drames tels que cette fameuse trahison dont le narrateur, mais avant lui son fidèle ami, ne se relèveront pas.
Alors ce dernier Besson (son 10ème en huit ans) n’est pas un grand livre, certes, mais il est de ces bouquins qui vous laissent, et pour longtemps, de drôles de traces indélébiles … de ces images si bien (d)écrites qu’elles font les bons romans.
Publié par
rupert
Libellés :
Pages
0
commentaires
![]()
dimanche 1 mars 2009
LA PLAGE
 Dans le sud, je ne reviens presque jamais sans honorer de quelques pas les rivages désertés qui, en dehors des périodes estivales, retrouvent le calme et la sérénité qu'avaient certaines matinées d’été dans mon enfance.
Dans le sud, je ne reviens presque jamais sans honorer de quelques pas les rivages désertés qui, en dehors des périodes estivales, retrouvent le calme et la sérénité qu'avaient certaines matinées d’été dans mon enfance.
A cette époque un peu lointaine, où la région n’était pas encore totalement défigurée par les hordes de promoteurs immobiliers auxquels des municipalités, peu regardantes sur leurs prétentions architecturales et plus concernées par le développement éventuel du bassin d’emploi que par le respect de l’environnement, sacrifièrent irréversiblement la côte méditerranéenne, les dunes qu’un vent marin venait fouetter et déplacer s’étendaient, me semblait-il, à l’infini et pour toujours.
La voiture empruntait alors une petite route goudronnée que le sable balayait, recouvrait, jusqu’à cette plage où seules quelques familles, attentives à la puissance d’un soleil qui ne tarderait pas à devenir insupportable, prenaient déjà du bon temps. Du temps, j’en ai passé moi aussi sur cette plage, cette jetée, et dans l’eau à regarder, car trop petit, mes sœurs plonger (les délicieux couteaux n’étaient encore pas si rares … aujourd’hui on n’en trouve même plus chez un bon poissonnier), et plus tard aux côtés d’une grand-mère attentive qui passait des heures à faire son crochet sous le parasol coloré …
Les souvenirs de ces époques (il y en eu plusieurs) se rappellent toujours nombreux, riches en détails fidèles qui me les rendent chers et vivants. Mais voilà, la plage désormais souillée de ces lointains étés ne m’attire plus que pour regarder, l’hiver, le soleil se coucher. Alors qu’il disparaît, je dédie sans regret à ces absents qui comptent et qui ne reviendront pas, quelques tendres pensées …
Publié par
rupert
Libellés :
Ensemble
7
commentaires
![]()