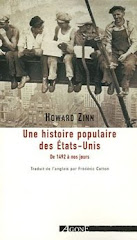Il n’est pas forcément besoin de chercher absolument l’originalité pour réaliser l’un des films les plus importants de sa carrière.
Il n’est pas forcément besoin de chercher absolument l’originalité pour réaliser l’un des films les plus importants de sa carrière.
Si dans le cas présent, et en fait de carrière, il s’agit seulement des trois premiers films d’un réalisateur assez jeune et donc encore susceptible de nous enthousiasmer (Little Odessa, The Yards ... dans le meilleur des cas) comme de nous décevoir (We Own The Night ... dans le pire) durant de longues années, la quatrième et dernière œuvre de James Gray, le (très) sombre et mélodramatique Two Lovers, s’inscrit brillamment en tête du palmarès de ce que le cinéaste a fait de mieux. En s’extirpant enfin des histoires mafieuses qui annonçaient déjà une marque de fabrique par trop évidente et dont on pouvait supposer qu’elles relevaient d’une totale absence de volonté à se diversifier, Gray s’approche de l’essentiel et, s’appropriant le postulat de base d’une nouvelle de Dostoievski (Nuits Blanches), filme simplement mais magnifiquement les états amoureux.
A seulement quelques heures d’intervalles, un jeune homme souffrant de troubles psychologiques, rencontre deux femmes très différentes l’une de l’autres, pour lesquelles il va ressentir des sentiments contradictoires qui vont de l’amour sage et résigné, à la passion dévorante, l’obsession ...
Autant dire le scénario casse-gueule par excellence, pour tout petit besogneux de studio sans ambition artistique qu’un manque flagrant d’inspiration aurait conduit à réaliser une énième comédie romantique.
Hors, chez Gray rien n’est évident. Car avant tout le simple, intime, est beau, il a de la gueule et du style, il est puissant, crépusculaire et laisse sensiblement apparaître toute la complexité des relations humaines (la famille, l’autre ...), des sentiments (le désir, l’espoir, l’attente, la résignation ...). On y est !
Les cadrages sont parfaits, les plans sont magnifiques ... un véritable virtuose. En s’appuyant sur le travail d’orfèvre de son chef opérateur en titre, Joaquin Baca-Asay (photo superbe), il dépouille, épure, retire toute illusion, tout décorum superflu, désamorce les codes habituels d’un genre archi rebattu, pour imprégner sa pellicule de pragmatisme, radical, et rendre l’ensemble incontestablement vrai, naturel, carrément fort. Très fort.
Porté par des acteurs exceptionnels (Joaquim Phoenix est impressionnant, Gwyneth Paltrow se révèle enfin, Vinessa Shaw happe la camera) et des seconds rôles intenses (dont Isabella Rosselini, parfaitement juste ...), Two Lovers déploie des trésors de talent sans jamais être dans la démonstration. Dépressif, nostalgique puis ténébreux, amer et au final bouleversant ... la chronique ordinaire du désespoir amoureux comme une maladie, une folie dans ce qu’elle aurait de plus profond, de plus troublant, de plus sincère et de plus beau. A voir absolument !!!
jeudi 27 novembre 2008
DIAMANT NOIR
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
2
commentaires
![]()
mardi 25 novembre 2008
GUY PEELLAERT
 C’est achetant le quatrième album d’Etienne Daho, Pour nos vies martiennes, que j’ai découvert l’artiste belge Guy Peellaert, auteur de l’oeuvre choisie pour illustrer la pochette. Le chanteur y était avantageusement représenté en « Marlon Brando de fête foraine » vêtu d’un tee-shirt blanc maculé et entouré de personnages secondaires échappés d’un univers sans lien direct avec celui de l’icône pop d’alors, qui par les soins d’un éclairage tout en demi tons permettait un rapprochement forcément volontaire avec les figures emblématiques et solitaires d’un Edward Hopper, moins à la mode à cette époque là.
C’est achetant le quatrième album d’Etienne Daho, Pour nos vies martiennes, que j’ai découvert l’artiste belge Guy Peellaert, auteur de l’oeuvre choisie pour illustrer la pochette. Le chanteur y était avantageusement représenté en « Marlon Brando de fête foraine » vêtu d’un tee-shirt blanc maculé et entouré de personnages secondaires échappés d’un univers sans lien direct avec celui de l’icône pop d’alors, qui par les soins d’un éclairage tout en demi tons permettait un rapprochement forcément volontaire avec les figures emblématiques et solitaires d’un Edward Hopper, moins à la mode à cette époque là.


Publié par
rupert
Libellés :
Hommages
3
commentaires
![]()
jeudi 20 novembre 2008
D'AUSSI LOIN QUE HOLLYWOOD
 Encouragée par le succès sans précédent de son Exhibition consacrée au fameux madrilène Pedro Almodovar, la Cinémathèque Française, pour le coup renforcée dans des choix de programmation éminemment plus grand public (mais n’oublions que le cinéma est l'art populaire par excellence), réitère l’heureuse expérience en accueillant et en confiant le premier rôle de sa dernière grande exposition à l’une des icônes de l’underground artistique californien, Dennis Hopper.
Encouragée par le succès sans précédent de son Exhibition consacrée au fameux madrilène Pedro Almodovar, la Cinémathèque Française, pour le coup renforcée dans des choix de programmation éminemment plus grand public (mais n’oublions que le cinéma est l'art populaire par excellence), réitère l’heureuse expérience en accueillant et en confiant le premier rôle de sa dernière grande exposition à l’une des icônes de l’underground artistique californien, Dennis Hopper.
Provocateur et figure contradictoire, voire controversée (dues notamment à une extraordinaire inconstance dans ses prises de positions politiques ...), mais avant tout incontournable des contre-cultures les plus radicales de la côte ouest (Easy Rider, son film sur la route, aux partis pris insolites), l’acteur, réalisateur, producteur, photographe, peintre, poète, ... Hopper est, outre une anti-star carrément border-line, un insatiable collectionneur d’art.
Ainsi, au fil d’une scénographie étriquée (au moindre mouvement on frôle les œuvres ... hum), mais qui parvient tout de même à ne jamais nous éloigner de l’essentiel, l’artiste, ancien anti-conformiste, s’impose comme le fil conducteur d’une passionnante immersion en ce Nouvel Hollywood (nouvelle vague contestataire qui donne une partie de son titre au projet), univers décalé et révélateur de ce touche-à-tout de génie.
S’y côtoient Basquiat, Warhol, Rauschenberg, Lichtenschtein, Schnabel (oui, que du très très bon), ou encore Viggo Mortensen, ... mais aussi une multitude de clichés noir et blanc (Jane Fonda, Martin Luther King ...) au milieu desquels Paul Newman, dont la disparition récente vient encore renforcer l’aspect résolument mélancolique d’un ensemble (véritable parenthèse de sur-créativité réactionnaire paradoxale) de très haute tenue muséale.
Représentant multicarte volontaire et volontariste d’une ville en crise toujours au bord de la rupture, Los Angeles, Dennis Hopper démontre ici avant tout une incroyable capacité d’appréhension, de démonstration et d’analyse d’une Amérique en perpétuelle mutation. Spirituel et mythique, conceptuel et physique ... passionnant !
Jusqu’au 19 janvier 2009
Publié par
rupert
Libellés :
Expos
0
commentaires
![]()
dimanche 16 novembre 2008
L'ÉCHANGE
S’appuyant sur une histoire vraie lui permettant de reconstituer avec force d’effets spéciaux le Los Angeles de 1928, Clint Eastwood filme Angelina Jolie anorexique dans le rôle d’une femme qui, à la recherche de son fils disparu, se bât contre les autorités corrompues …
D’abord le constat, fatal : rarement le cinéaste aura été aussi malhabile, lourd, démonstratif, rarement il sera passé de manière aussi évidente à côté de son sujet, ici pourtant fort attirant. Caricaturant sa vision d’une ville et d’une époque pour en faire une parabole brouillonne et classique du monde austère qu’il aura passé sa carrière à explorer et à exploiter (souvent avec talent et bonheur), le réalisateur s’englue dans une démonstration photogénique sans saveur ni passion, incapable de s’épargner un manichéisme étonnant qui vire au thriller sordide, violent et déplacé lorsqu’il s’agit de tenir le spectateur en haleine.
Comparable à une mixture indéfinissable dont la surabondance d’ingrédients hétérogènes finirait par ôter tout goût dominant et donc tout intérêt, ce Changeling trop « clean », trop maitrisé, mais aux intentions très floues (ou alors extrêmement limitées … au choix), compile les genres au fil de scènes (dont certaines vraiment gâchées … quel dommage !) que la star de circonstance, assez médiatique et surprenante (physiquement parlant) pour qu’on y attache de l’intérêt, s’approprie grossièrement et sans aucun effort.
De cette interprétation un rien trop décalquée sur le jeu dont le réalisateur, lorsqu’il est aussi acteur, s’est fait lui-même une spécialité, ressort un personnage pour lequel toute empathie s’avère paradoxalement impossible. Un comble !!!
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
21
commentaires
![]()
samedi 15 novembre 2008
MENSONGES D'ÉTAT
 Contrairement à son tâcheron de frère, Tony, pas totalement médiocre mais incapable de s’approprier un sujet pour en faire un œuvre personnelle, Ridley Scott est l’auteur reconnu de films cultes auquel le cinéma hollywoodien ne cesse de se référer.
Contrairement à son tâcheron de frère, Tony, pas totalement médiocre mais incapable de s’approprier un sujet pour en faire un œuvre personnelle, Ridley Scott est l’auteur reconnu de films cultes auquel le cinéma hollywoodien ne cesse de se référer.
D’Alien (génial) à Gladiator (intéressant), en passant par la brillante adaptation du roman de Philip K. Dick, Blade Runner (5 versions tout de même), ou le magnifique road movie Thelma & Louise, ..., si une bonne partie de la filmographie du réalisateur restera dans les annales de tout cinéphile qui se respecte, certaines tentatives ou redites dans des registres plus « classiques » (le polar avec Someone To Watch Over Me et Black Rain, la reconstitution historique avec 1492 ou Kingdom of Heaven ...) n’ont pas toujours marqué les esprits.
Aussi, tout réussi qu’il soit, Body of Lies risque fort d’allonger la liste des films qui se situent dans cette deuxième catégorie. La raison n’en incombera pas aux acteurs, dont les prestations franchement enthousiasmantes complètent une réalisation efficace et honnête, permettant ainsi de cerner au mieux le propos : entourés d’une pléiade de seconds rôles capitaux, DiCaprio, plus mature qu’à l’accoutumée, perfectionne son art de l’identification voire celui de la transformation en jouant les infiltrés en milieu « hostile » alors que Russel Crowe, dont c’est la quatrième collaboration avec Scott, semble assumer sans peine la fonction d’acteur fétiche sous-employé dont on ne saurait regretter une participation somme toute assez sporadique.
Mais, la complexité d’un scénario sensiblement retors (l’adaptation d’un roman éponyme du journaliste du Washington Post, David Ignatius, salué pour sa description des méthodes des services d'espionnage américains), que certaines grosses ficelles permettent d’appréhender avec un peu plus de facilité, ne parvient pas à compenser une impression de déjà-vu évidente (The Kingdom de Peter Berg, Rendition de Gavin Hood ...).
Du coup, à la traîne derrière des prédécesseurs auxquels il n’a pourtant rien à envier, Body of Lies apparaît « juste » comme un bon film d’espionnage classique très bien ficelé, mais pas révolutionnaire. Un dénouement moins surprenant que l’entrée en matière d’une intrigue à la Le Carré, où l’amorce d’une romance semble dramatiser l’action, complètera ce tableau un peu gâché par l’absence de véritable ambition. A voir malgré tout !
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
0
commentaires
![]()
mercredi 12 novembre 2008
MONUMENT VALLEY
Sa structure singulière de type aclinale révèle un plateau parsemé de monolithes géants, formations de grès ayant résistées à une érosion ayant débutée il y a plus de 25 millions d’années, et dont les couleurs vives proviennent d’oxyde de fer et de manganèse.
The Mittens – left and right - et Merrick Butte, les 3 plus représentatives et spectaculaires, sont hautes d’environ 300m et distantes l’une de l’autre d’à peu près 1km.

 Depuis John Ford, qui décida d’en faire le lieu principal des prises de vue de Stagecoach (1938), western dans lequel John Wayne faisait ses débuts, Monument Valley fut le décor extraordinaire d’une multitude de films (la Chevauchée fantastique et la Prisonnière du désert du même John Ford, mais aussi Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, 2001 de Stanley Kubrick, la Sanction de et avec Clint Eastwood qui profita de l’occasion pour escalader l’une des fameuses buttes, ou encore Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg et Forrest Gump de Robert Zemeckis …), ainsi que l’emblème de la fameuse marque de cigarettes Marlboro à partir des années 50.
Depuis John Ford, qui décida d’en faire le lieu principal des prises de vue de Stagecoach (1938), western dans lequel John Wayne faisait ses débuts, Monument Valley fut le décor extraordinaire d’une multitude de films (la Chevauchée fantastique et la Prisonnière du désert du même John Ford, mais aussi Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, 2001 de Stanley Kubrick, la Sanction de et avec Clint Eastwood qui profita de l’occasion pour escalader l’une des fameuses buttes, ou encore Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg et Forrest Gump de Robert Zemeckis …), ainsi que l’emblème de la fameuse marque de cigarettes Marlboro à partir des années 50. 
Publié par
rupert
Libellés :
Ailleurs
5
commentaires
![]()
mardi 11 novembre 2008
GEORGES WALKER ...
 ... Bush, Président improbable ? C’est du moins ce qu’entend démontrer Oliver Stone avec ce film « attirant » qui semble avoir été écrit et réalisé parce que le sujet était encore de circonstance. En effet, qui se souciera encore d’aller voir un biopic sur Bush Junior quand celui-ci aura définitivement décampé de la Maison Blanche ?
... Bush, Président improbable ? C’est du moins ce qu’entend démontrer Oliver Stone avec ce film « attirant » qui semble avoir été écrit et réalisé parce que le sujet était encore de circonstance. En effet, qui se souciera encore d’aller voir un biopic sur Bush Junior quand celui-ci aura définitivement décampé de la Maison Blanche ?
Parcours décliné au fil d’un montage à la structure moins hasardeuse qu’il y paraît, alternant les séquences intimistes (ses rapports parfois violents avec son père, la froideur de sa mère, sa rencontre éméchée avec sa future femme …) et les nombreux échanges avec ses collaborateurs (Cheney l’abominable, Powell le lâche et Rice la soumise …), W. met à profit les reconstitutions politiques et historiques (vérifiées) jouissives, mais pêche considérablement dans celles de la sphère privée (fictionnelles) du 42ème Président des Etats-Unis.
Alors même si l’on s’étonne encore (comment ce type a pu arriver là ?), et même si l’on se régale franchement des prestations de Josh Brolin (bluffant) en W. consternant, de Richard Dreyfuss en Cheney véritablement inquiétant, de Thandie Newton, dont le pastiche ridicule de Rice en clone de Zira n'en demeure pas moins limite, Stone, pamphlétaire corrosif ici en mode mineur, aurait été plus inspiré en relatant les faits, et seulement les faits, plutôt qu’en pénétrant aventureusement le cadre familial d’un homme dont le portrait « psychologique » s’apparente plus à une tragédie grotesque qu’au constat cinglant tant attendu.
D’où l’empathie involontaire et forcément coupable résultant de cette évidente approximation, due sans aucun doute à l' absence de prise de position.
A vouloir ménager la chèvre et le chou tout au long d’une narration que l’actualité de ces dernières années (en fait les 4 premières de la présidence de Bush) aurait suffit à alimenter, le réalisateur emmène le spectateur dans les méandres d’une réflexion totalement confuse. Dommage …
Publié par
rupert
Libellés :
Ecrans
2
commentaires
![]()